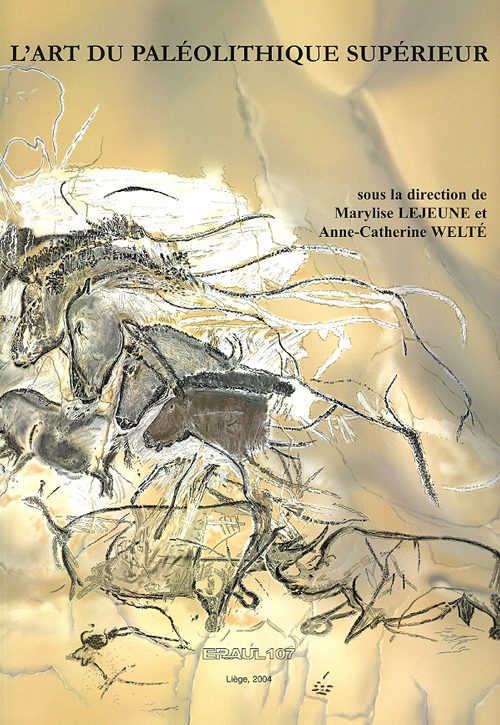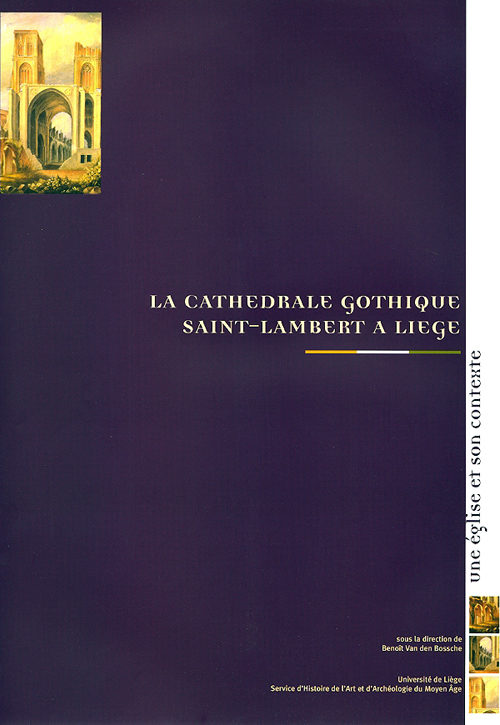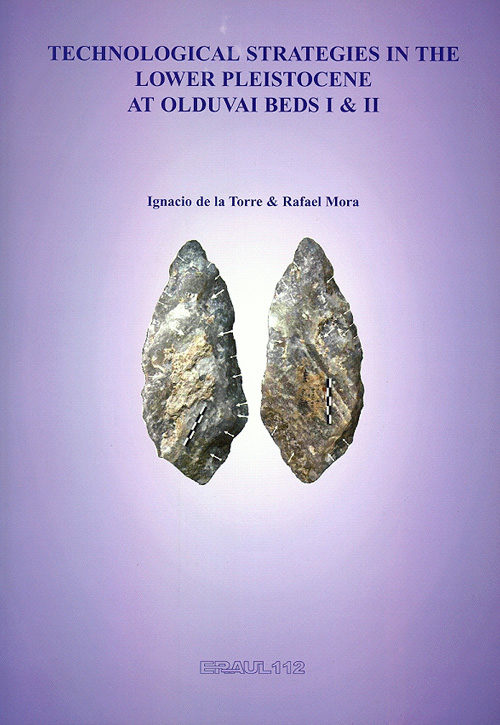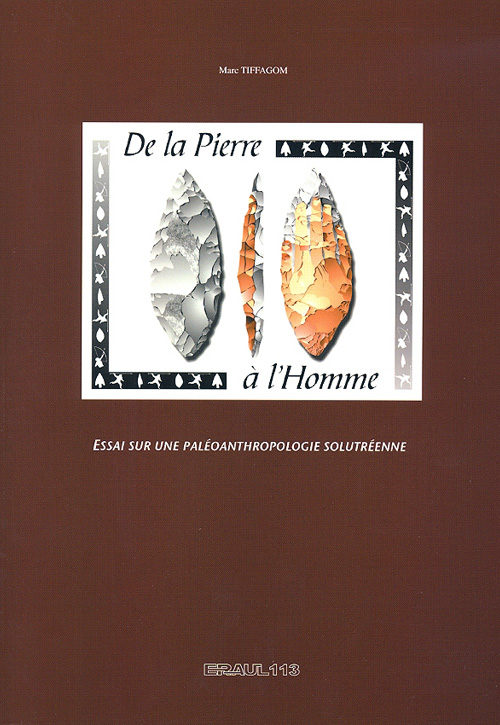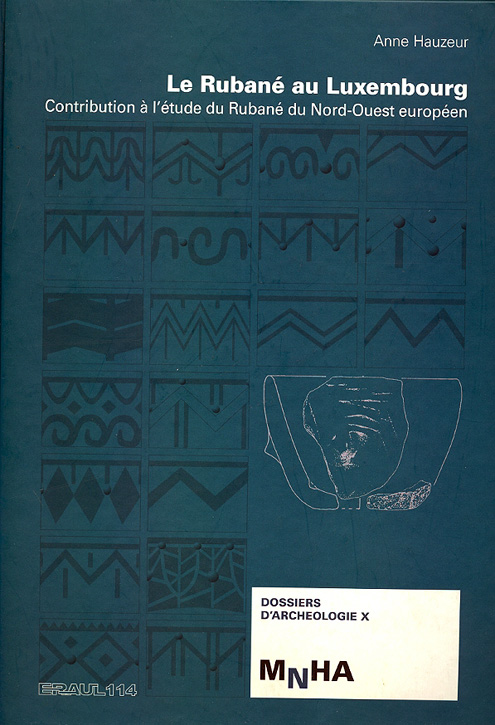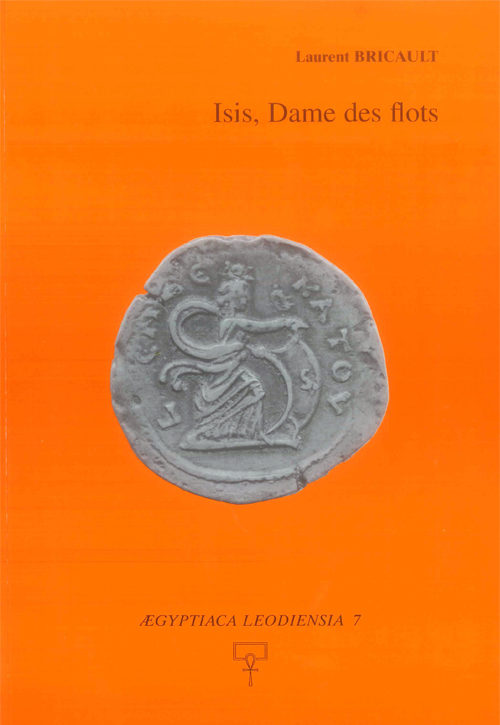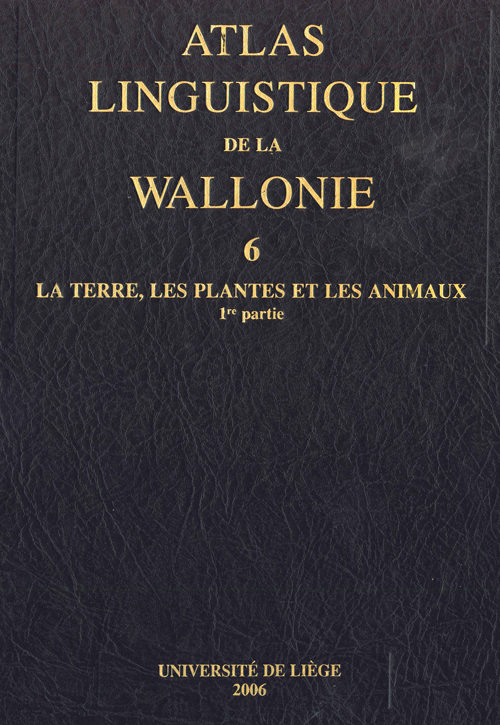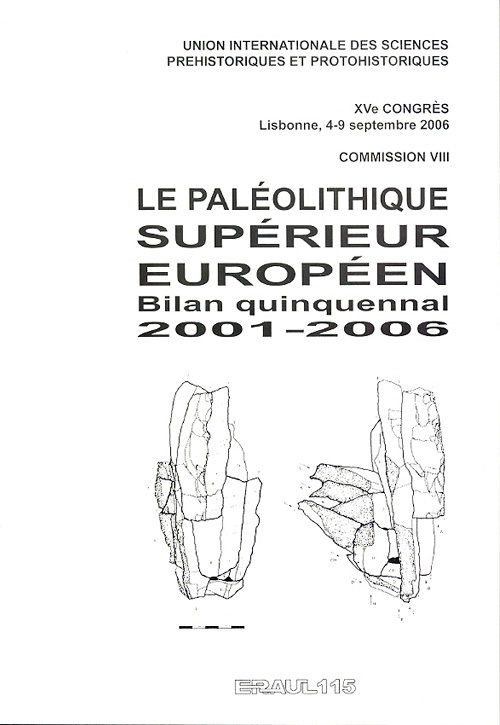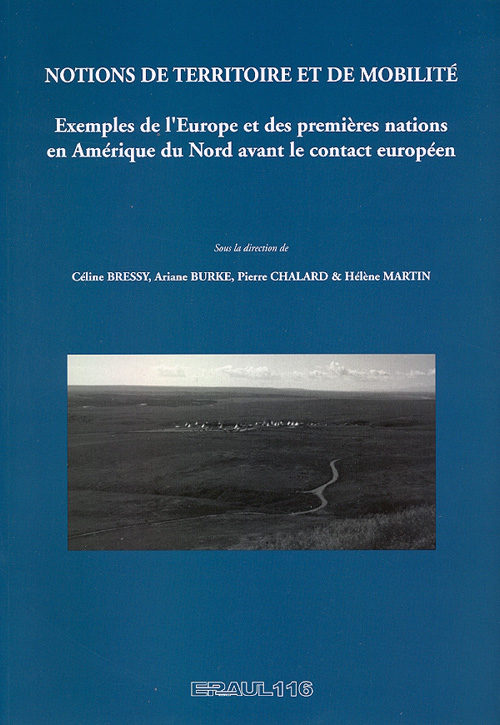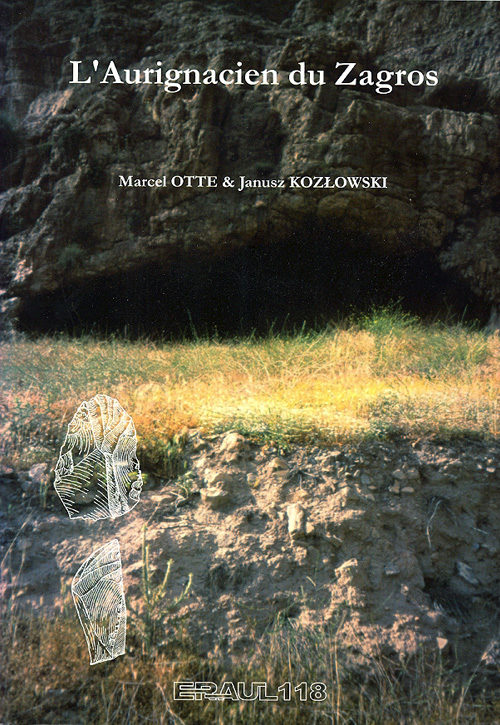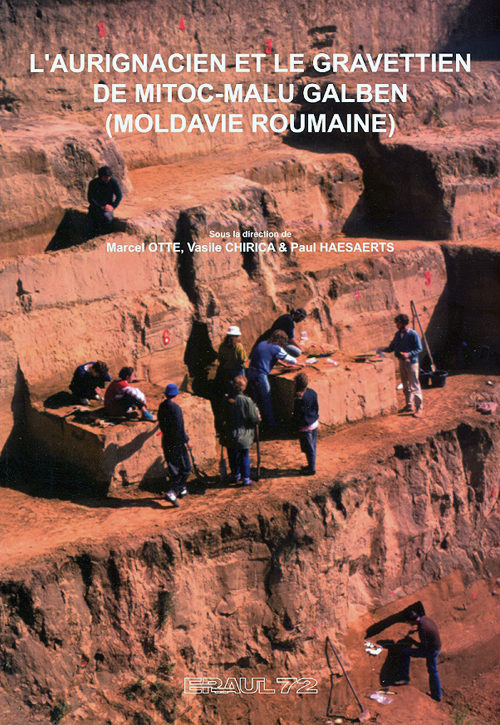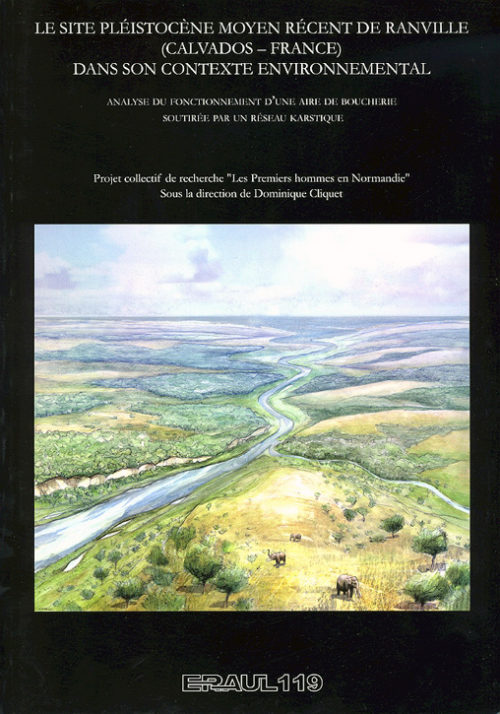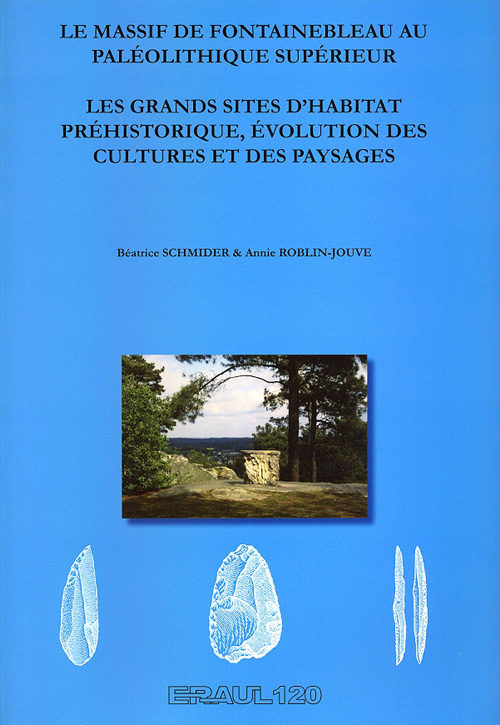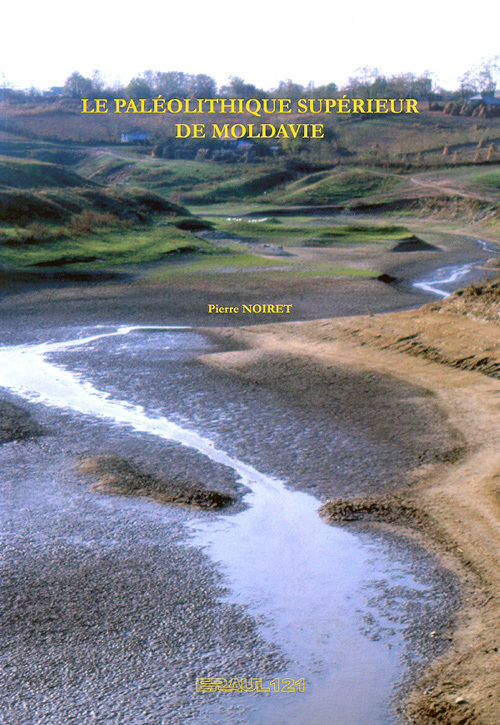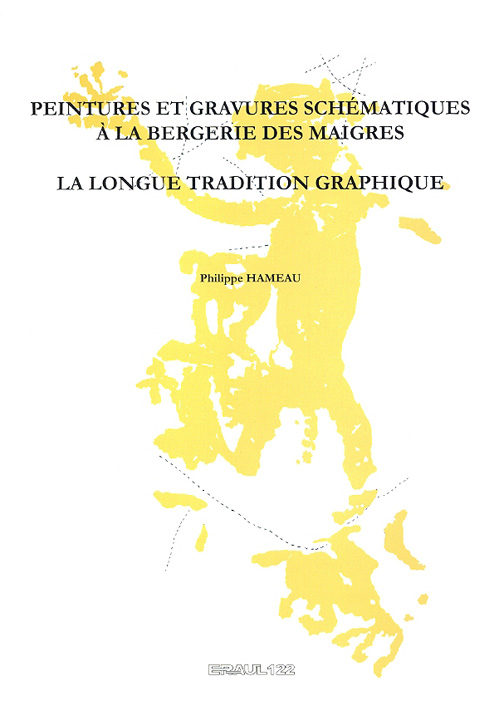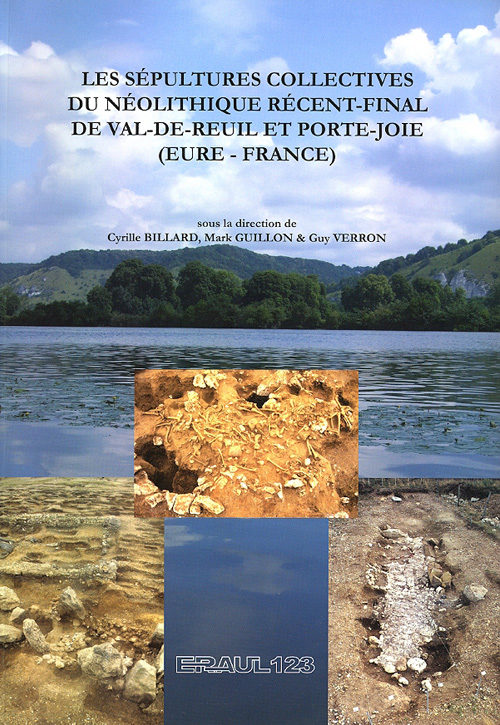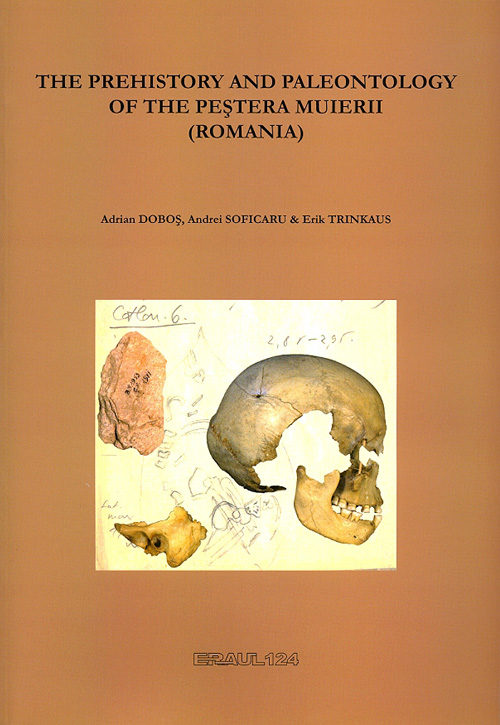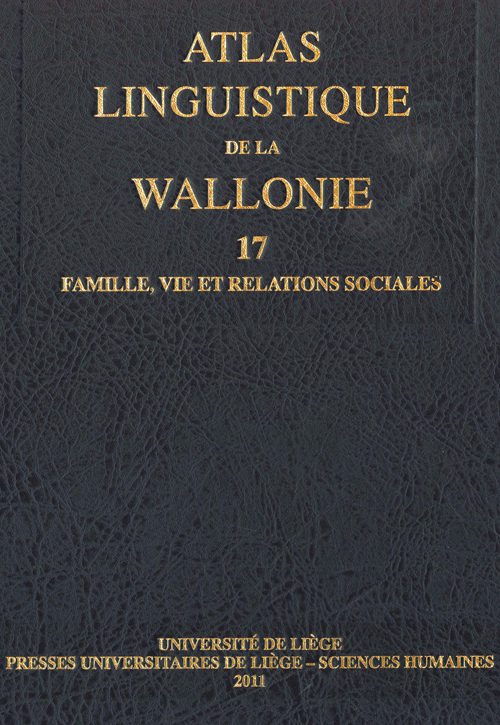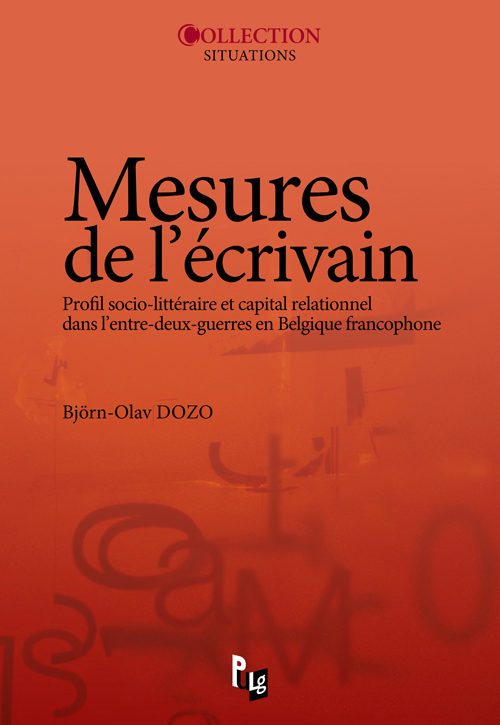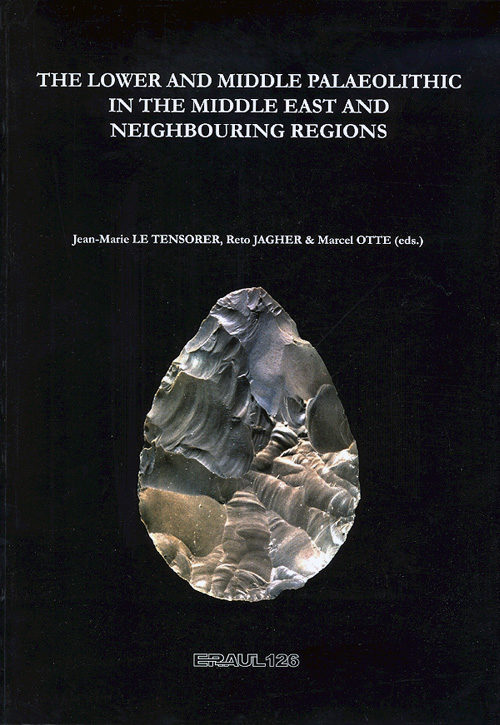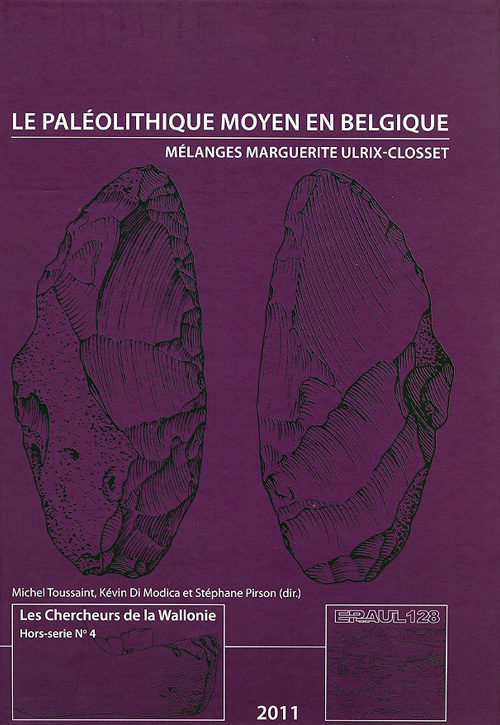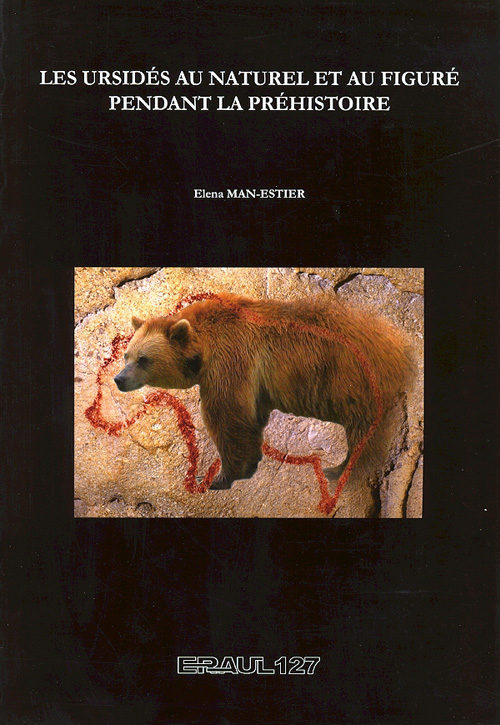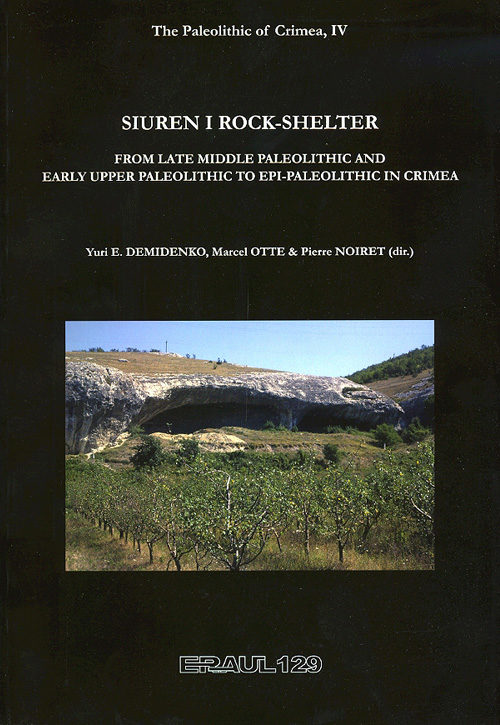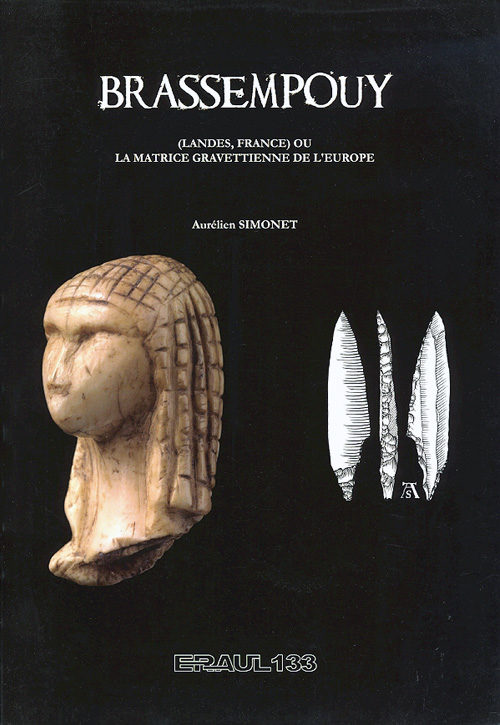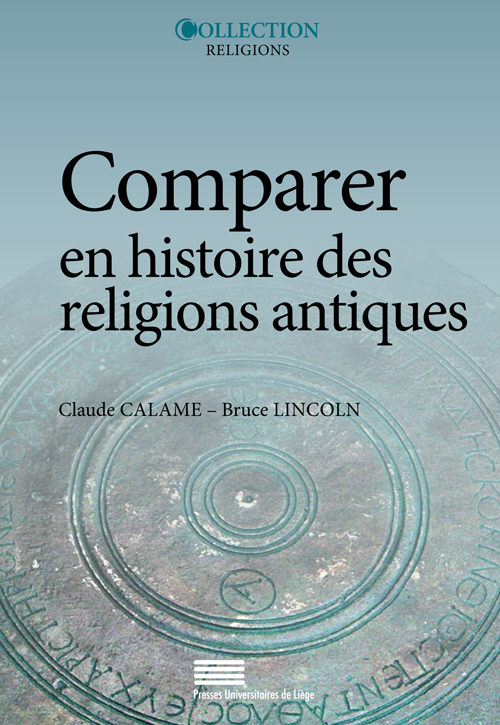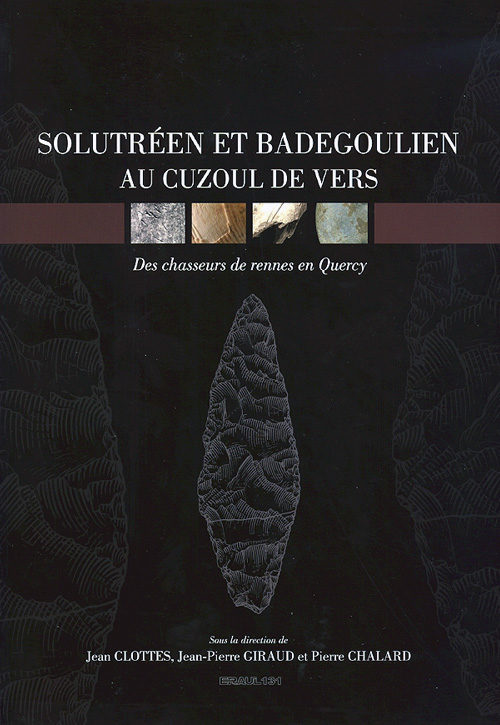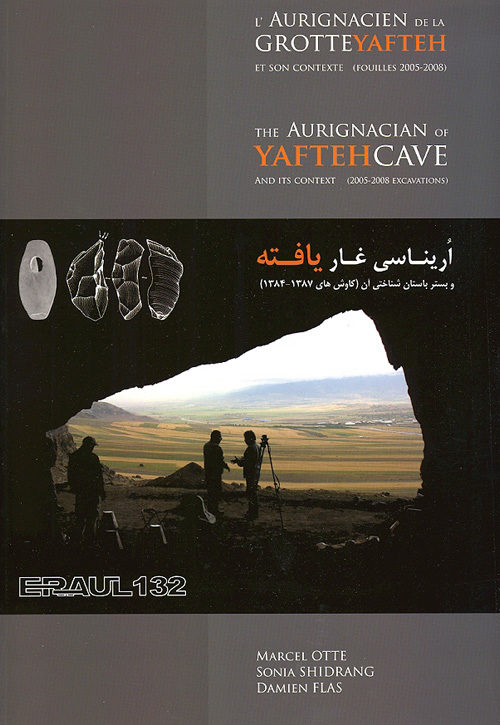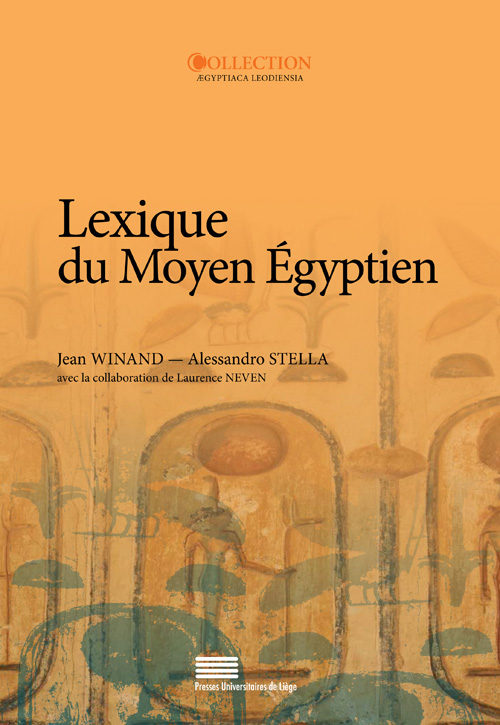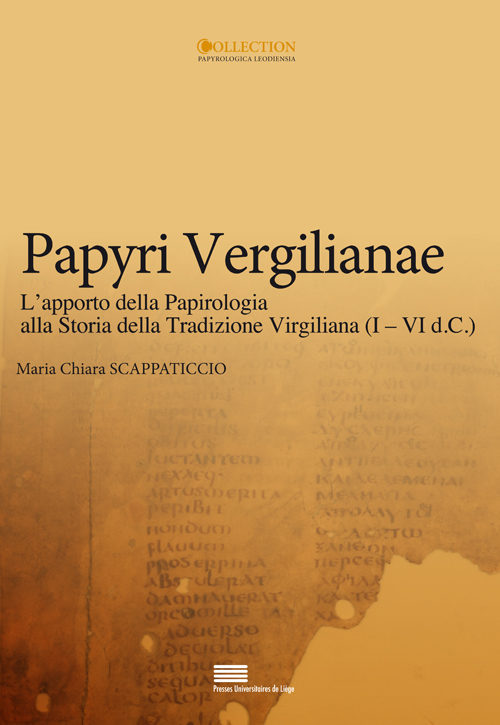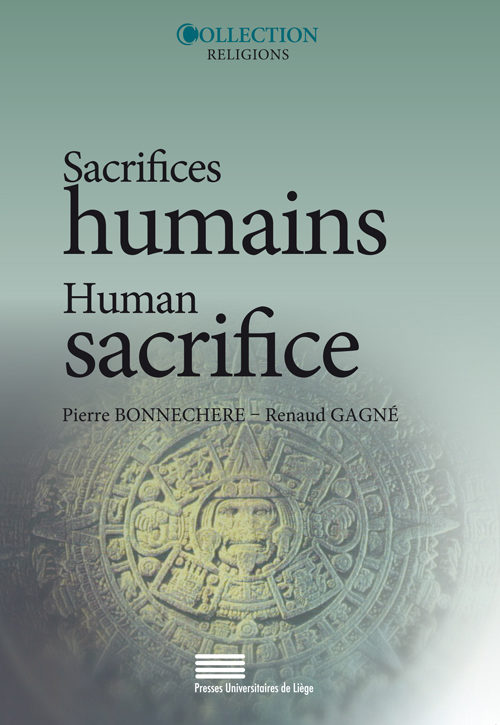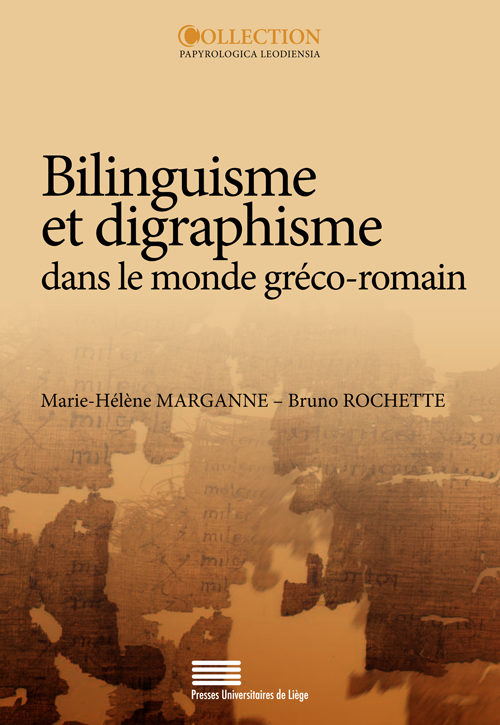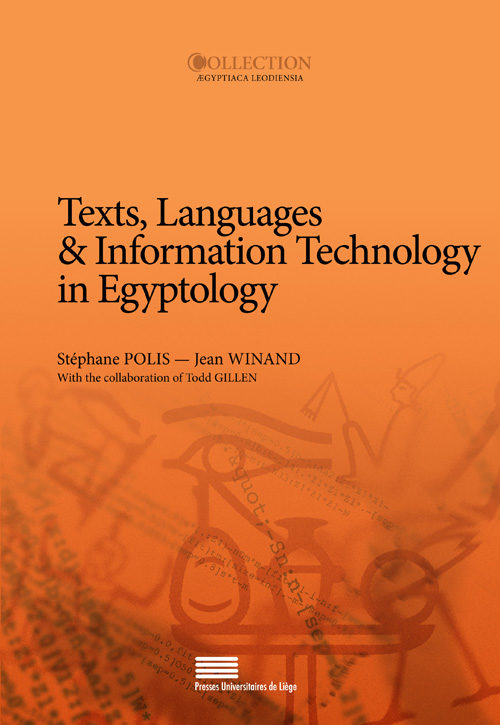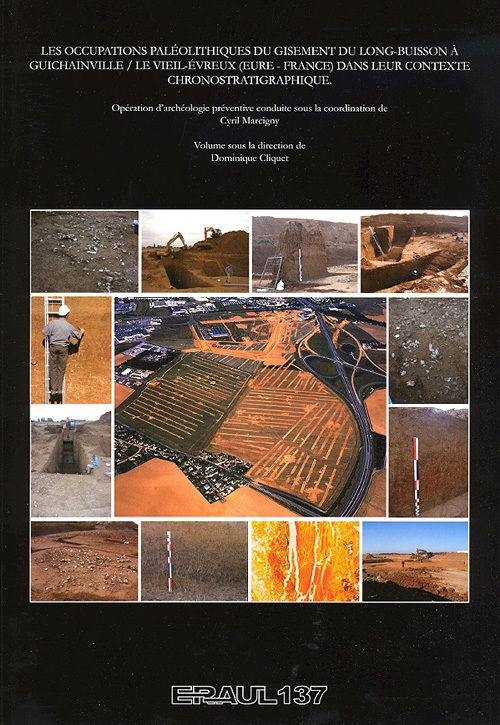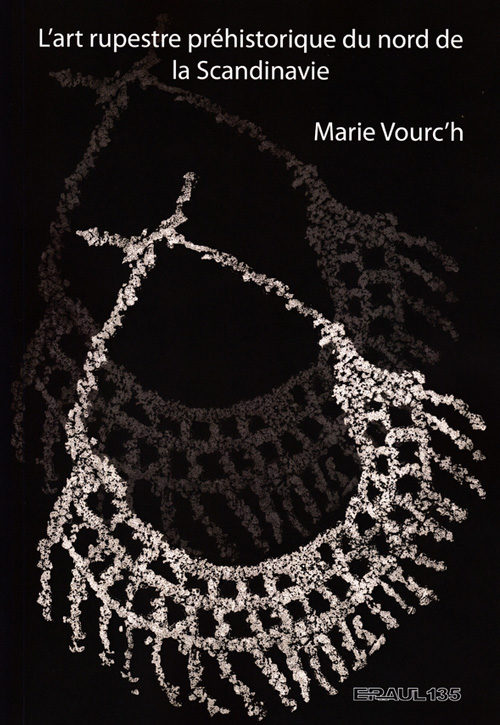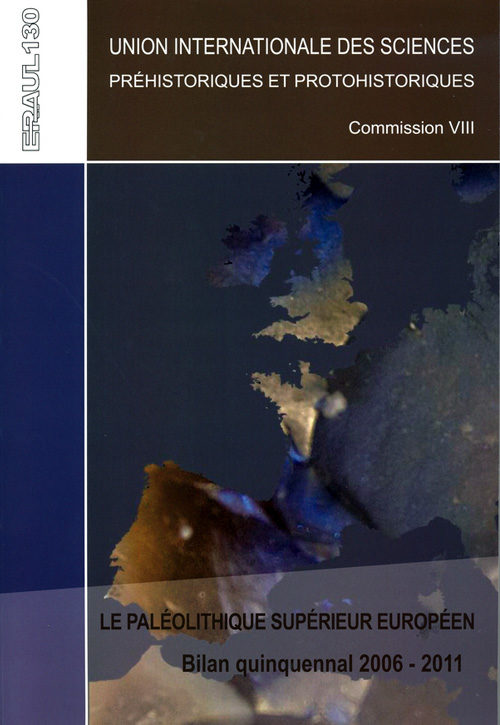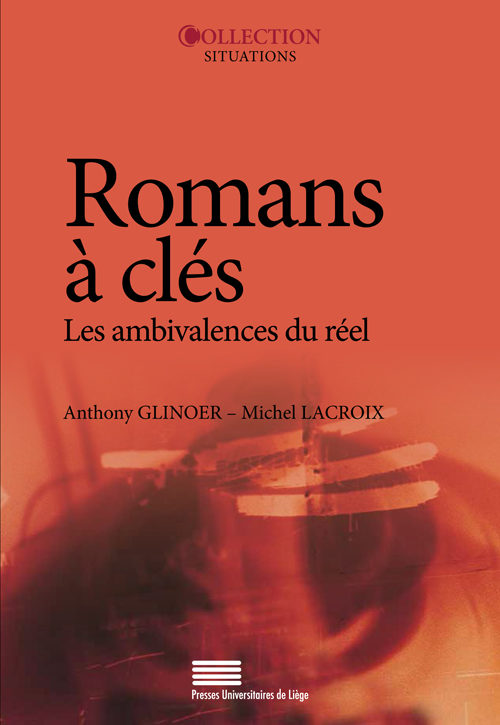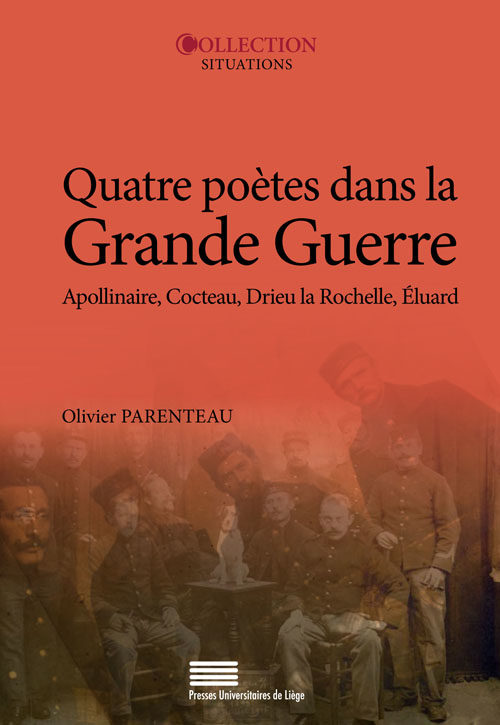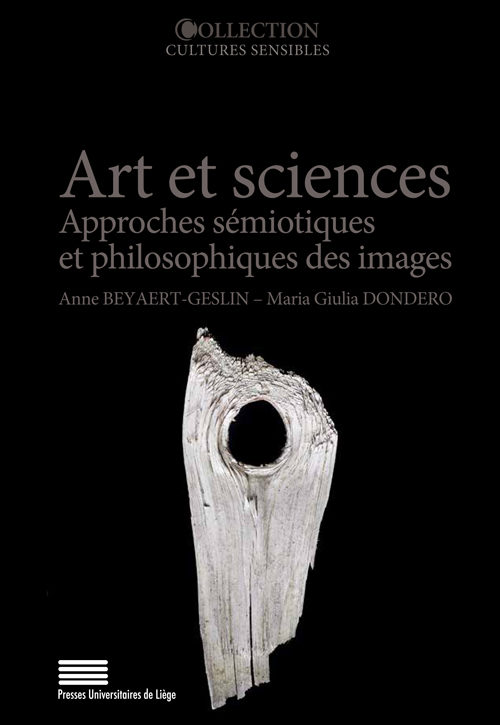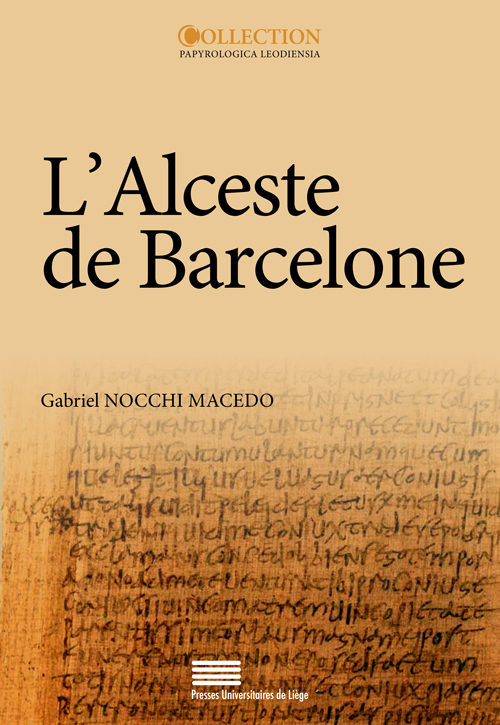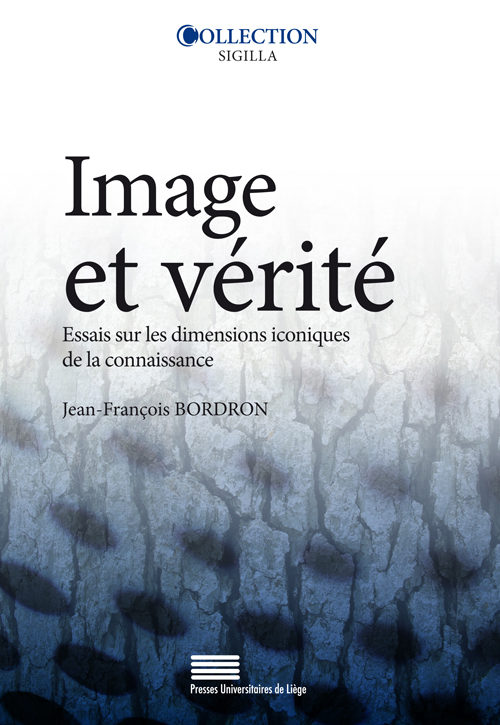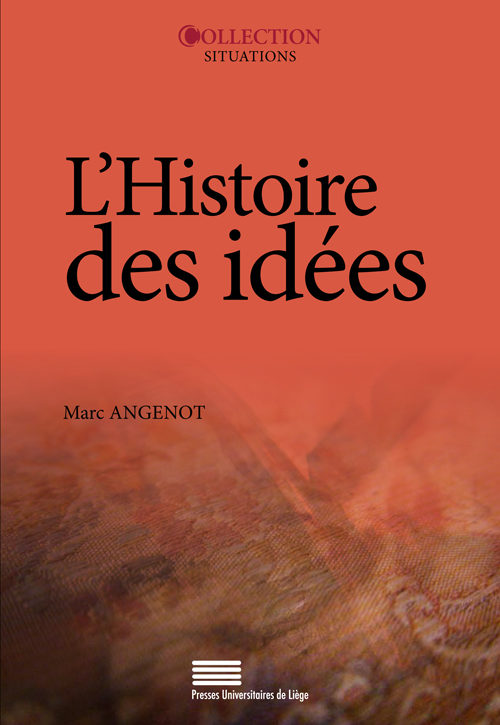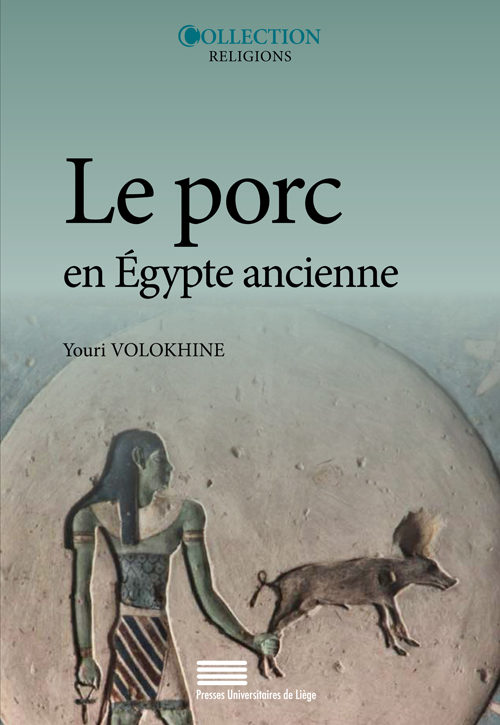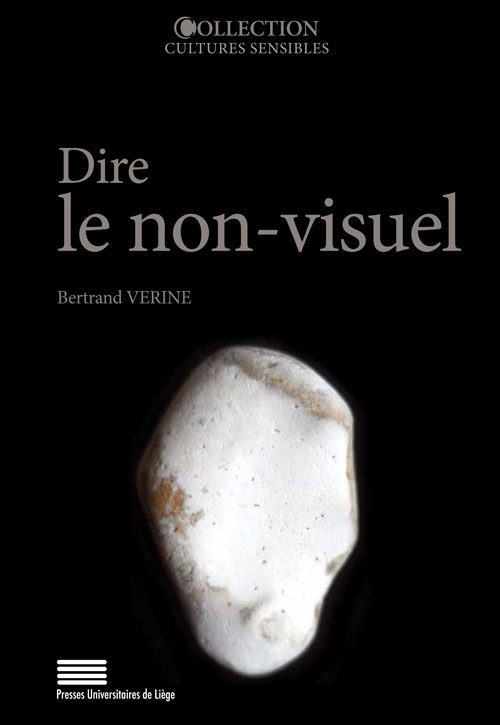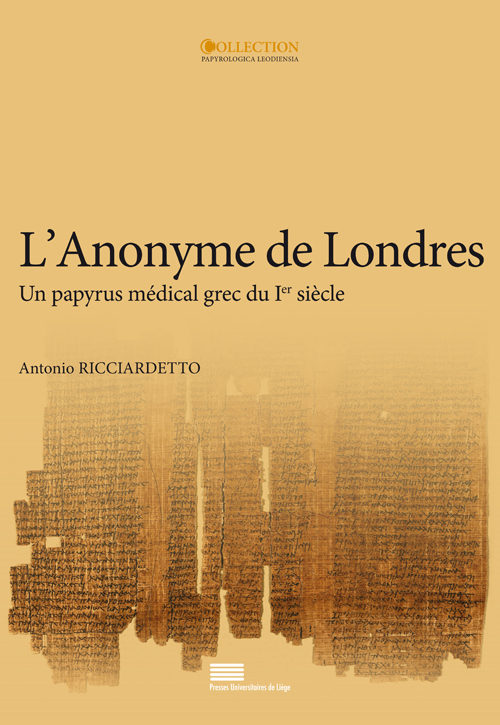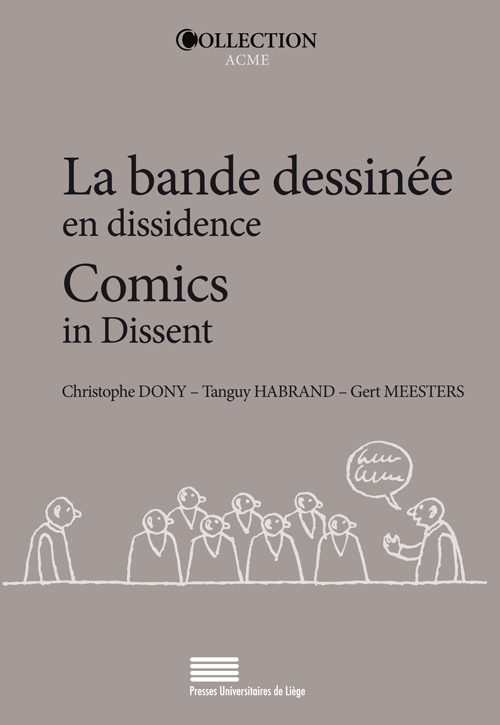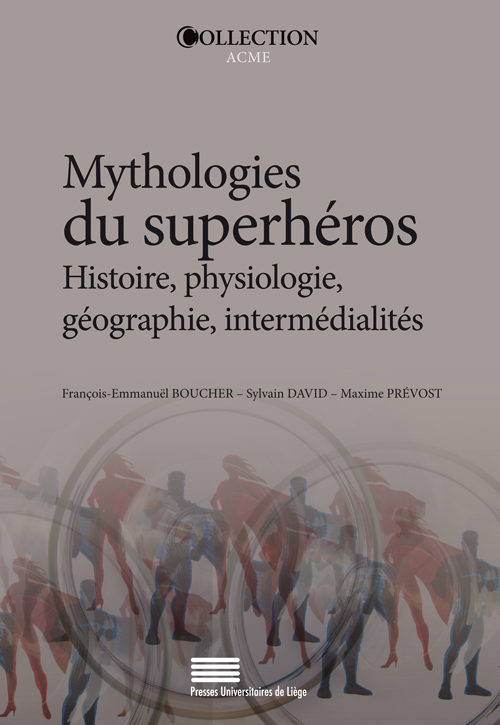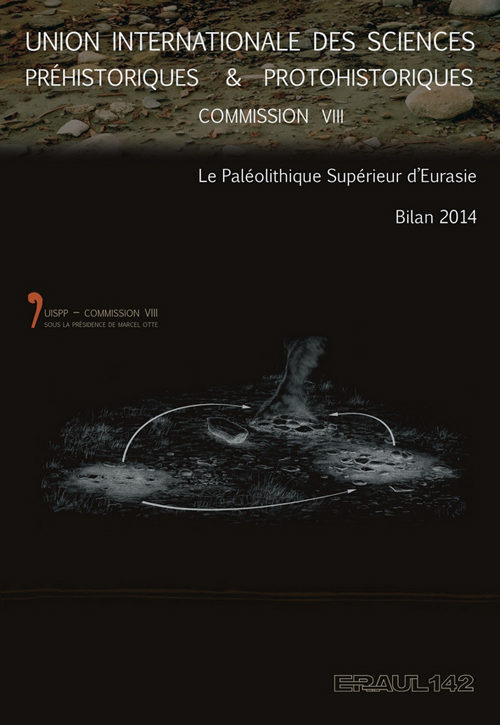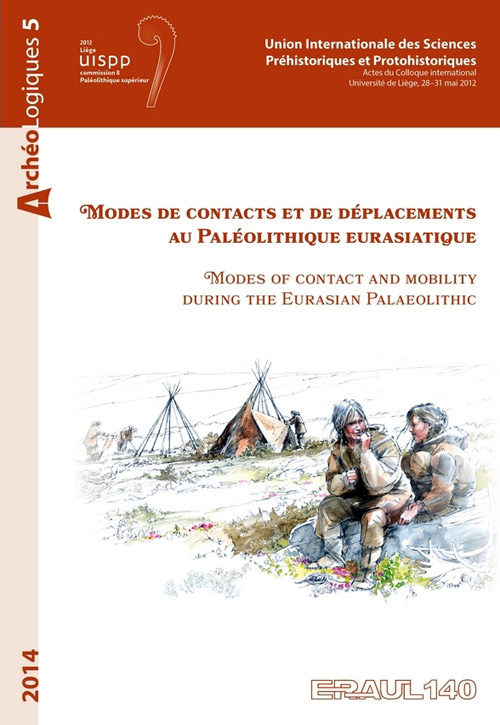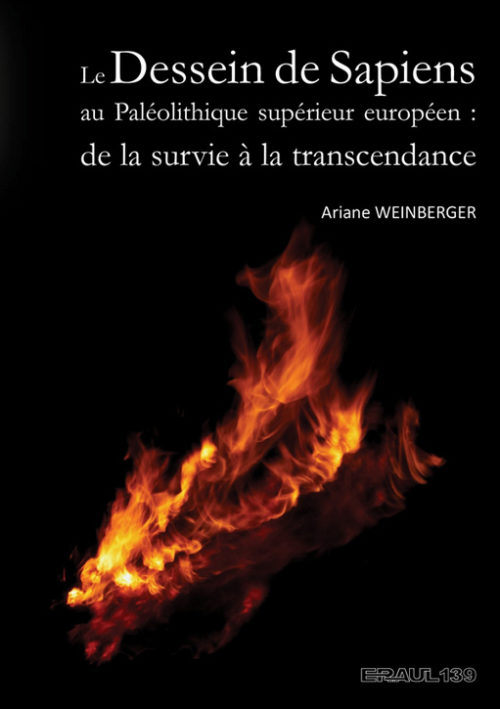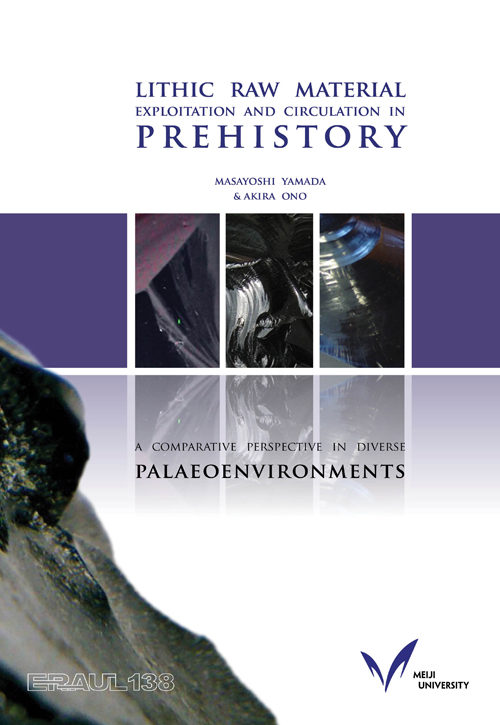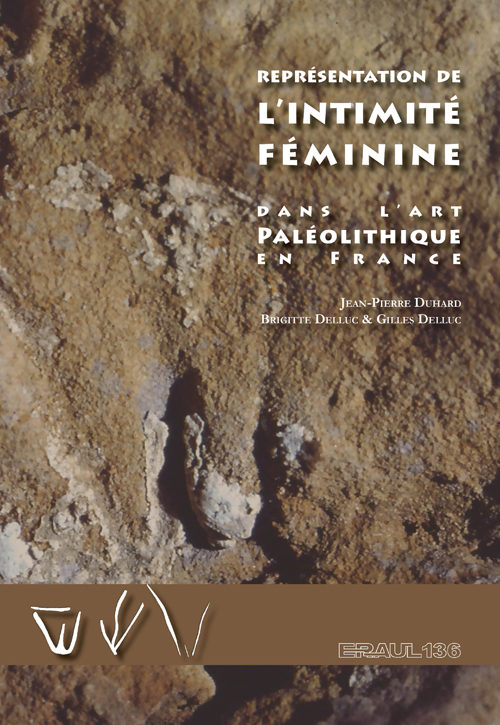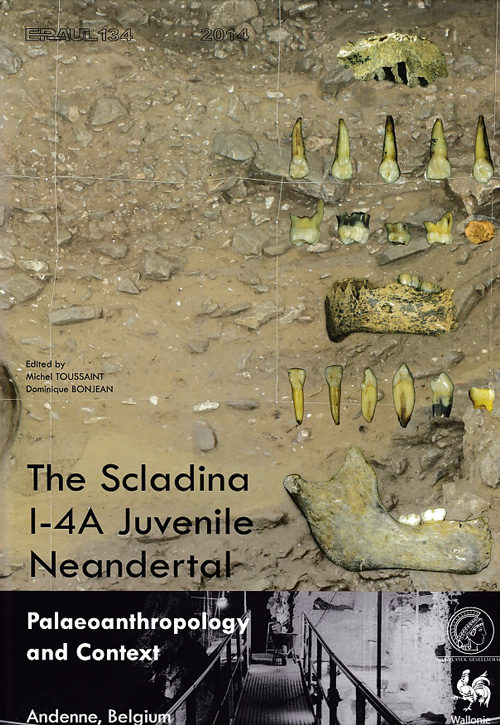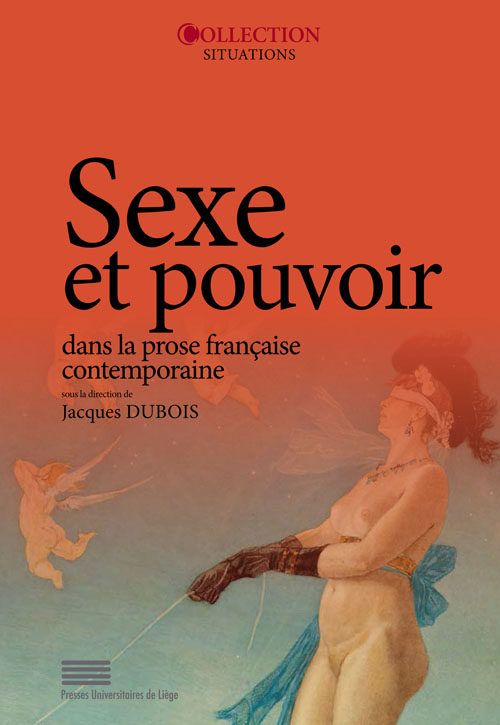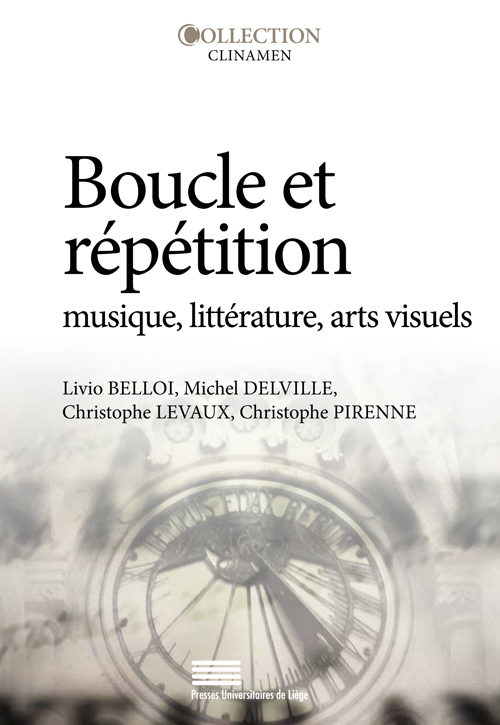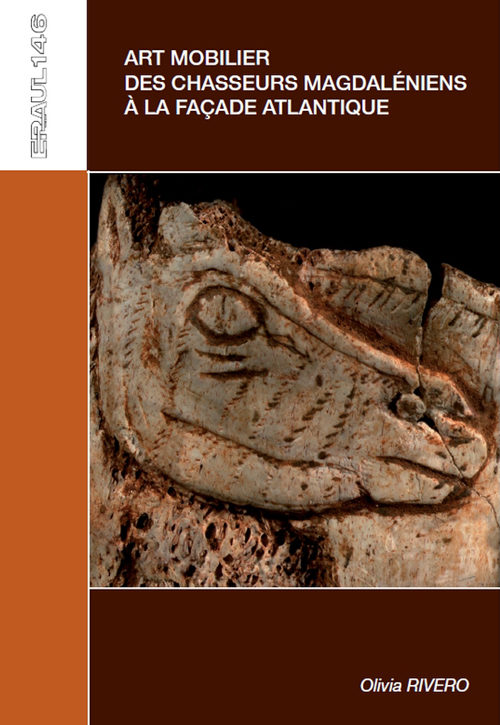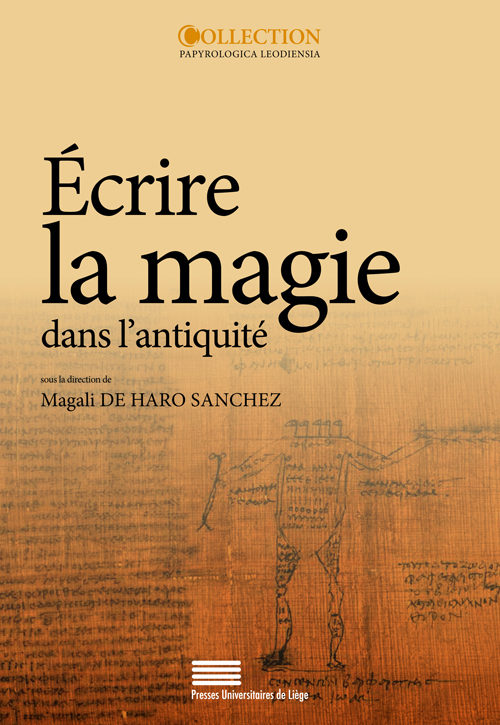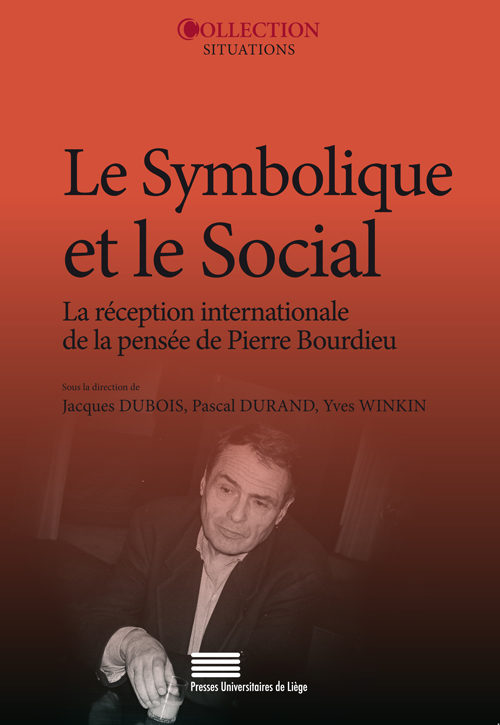I. colloque 8.2 : L’art pariétal paléolithique dans son contexte naturel Architecture de l’art pariétal paléolithique | Denis Vialou Quelques réflexions sur le rôle de la paroi rocheuse dans l’art du Paléolithique supérieur | Marylise Lejeune Dialogue avec la paroi : cas des représentations paléolithiques de la grotte ornée Mayenne- Sciences ( Thorigné-en-Charente, Mayenne) | Romain Pigeaud La grotte ornée de Cussac Le Buisson-de-Cadouin (Dordogne) | Norbert Aujoulat, Jean-Michel Geneste, Christian Archambeau, Marc Delluc, Henry Duday & Dominique Gambier Marsoulas : une grotte ornée dans son contexte culturel | Carole Fritz & Gilles Tosello Grotte Chauvet-Pont d’ Arc : approche structurelle et comparative du Panneau des Chevaux | Gilles Tosello & Carole Fritz L’art à l’Abri Pataud (les Eyzies, Dordogne) | Brigitte & Gilles Delluc Les représentations paléolithiques de salmonidés : mise en lumière de phénomènes culturels par l’analyse statistique des caractères formels | Pierre Citerne Kraft und Aggression. Existe-t-il un message de « force » et d’« agressivité » dans l’art Paléolithique ? | Jordi Serangeli Peut-on attribuer des œuvres du Paléolithique supérieur ? | Marc Groenen, Didier Martens & Pierre Szapu II. colloque 8.3 : Art mobilier paléolithique supérieur en Europe occidental La « magie de la chasse »: étude d’une gravure magdalénienne sur bois de renne provenant de l’abri classique de Laugerie-Basse (Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne) dans la collection Christy du British Muséum, Londres | Carole Rivenq Évolution stratigraphique des actions non utilitaires dans le Magdalénien supérieur de Roc-la-Tour I | Colette & Jean-Georges Rozoy L’art mobilier sur pierre de l’abri Gandil à Bruniquel (Tarn-et-Garonne, France) : étude synthétique | Edmée Ladier L’art mobilier non classique de la grotte magdalénienne de Bédeilhac (Ariège) | Georges Sauvet Un atelier magdalénien de sculpture de la stéatite au Rocher de la Caille (Loire) ? | Sophie A. de Beaune Aux origines de la représentation : les statuettes paléolithiques de l’Italie centrale et méridionale | Daniela Zampetti & F. Alhaique L’art mobilier sur pierre du versant sud des Pyrénées : les blocs gravés de la grotte d’Abauntz | Pilar Utrilla, Carlos Mazo, Maria Cruz Sopena, Rafael Domingo & Olaia Nagore L’art mobilier magdalénien de Moravie (République Tchèque). Les relations avec l’art mobilier français | Martina Laznickova Les concepts artistiques des représentations féminines dans les habitats du Paléolithique supérieur récent en Europe orientale en comparaison avec ceux du Magdalénien moyen en Europe occidentale | Lioudmila Iakovleva L’art mobilier du Magdalénien supérieur des sites de la vallée de l’Aveyron et d’Europe centrale : relations et/ou convergences ? Anne-Catherine Welté & Georges-Noël Lambert L’art paléolithique dans son système culturel : essais de corrélations. I. Chronologie, « Styles » et « Cultures » | François Djindjian Originalité spiritualiste des prêtres préhistoriens quant aux interprétations sur l’art mobilier en France (1864 – 1950) | Fanny Defrance
-
Actes des colloques 8.2 et 8.3, XIVe Congrès de l’UISPP, Liège (2-8 septembre 2001) par Marylise LEJEUNE & Anne-Catherine WELTE (dir) Avant-propos
-
Une église et son contexte. Actes du colloque international de Liège, 16-18 avril 2002, Liège par Benoît VAN DEN BOOSCHE (dir.) Table des matières Préface | Marcel Otte Une cathédrale franco-germanique: Saint-Lambert de Liège à l’époque gothique. Le colloque | Benoît Van den Bossche Aux origines de la cathédrale gothique Saint-Lambert de Liège | Jean-Marc Léotard La cathédrale gothique Saint-Lambert à Liège: apport des sources écrites | Alain Marchandise Les pratiques liturgiques au XIVe et au XVe siècle dans la cathédrale Saint-Lambert de Liège | Catherine Saucier L’architecture de Saint-Lambert à Liège au XIIIe et au XIVe siècle: essai de reconstitution et d’interprétation | Mathieu Piavaux Le message des pierres de la cathédrale Saint-Lambert à Liège: état de la question | Albert Lemeunier et Anne Warnotte La démolition de la cathédrale Saint-Lambert à Liège | Philippe Raxhon Essai sur la réception du gothique en Belgique (vers 1150-1250) | Luc F. Genicot Entre tradition et renouveau: les églises des ordres réguliers dans le diocèse de Liège au XIIIe et au XIVe siècle | Thomas Coomans Églises liégeoises en chantier au XIIIe et au XIVe siècle | Patrick Hoffsummer, Francis Tourneur, Frans Doperé et Mathieu Piavaux Anmerkungen zur Kölner Architektur um 1200 | Norbert Nussbaum Liège et la France. Les liens de Saint-Lambert avec l’architecture de l’ancienne province ecclésiastique de Reims de la fin du XIIe au milieu du XIIIe siècle | Dany Sandron Cathédrales aux confins du Royaume et de l’Empire. Les églises-mères de Tournai, Cambrai et Liège | Jeroen Westerman Une reconstitution virtuelle en trois dimensions de la cathédrale de Strasbourg. Méthodologie informatique appliquée aux restitutions architecturales | Stéphane Potier La peinture murale gothique au XIIIe et au XIVe siècle dans le diocèse de Liège | Anna Bergmans Conclusions | Jean-Louis Kupper
-
par Ignacio DE LA TORRE & Rafael MORA Abstract
This book envisages an analysis of the lithic collections from several sites Mary Leakey excavated between 1960 and 1963 in Bed I and II at Olduvai (Tanzania), currently stored at the National Museum of Nairobi (Kenya) and previously published in a classic monograph (Leakey 1971). Nonetheless, we have conceived this study from a standpoint that relates more to aspects concerning technical production than to the typological issues that governed Leakey’s approximation. Furthermore, the Olduvai collections will be contemplated from a contextual prism, bearing in mind a constant concern in reconstructing the processes that formed the archaeological record, aiming to understand the differences or similarities that appear between the different assemblages. This monograph focuses on the analysis of lithic materials. We assume blood cannot be squeezed from stones, paraphrasing the title of one of the articles by Isaac (1977b). Yet, we can reconstruct part of the puzzle concerning human evolution by understanding the technological guidelines and technical patterns in use during the transformation processes, which are, in short, telling of the hominids´ behaviour. A meticulous analysis of the lithic objects can provide valuable information to comprehend their technical abilities, cognitive skills and economic concerns. Therefore, each lithic object will be studied analytically, attempting to integrate them in the corresponding stage of the chaîne opératoire. It is essential to keep a distance from the last works that examined the Olduvai sequence (Ludwig 1999; Kimura 1997, 1999, 2002). Therein, artefact categories stand their own ground (in a classically typological conception), and are compared in isolation throughout a chronological sequence. In contrast, we consider that it is essential to analyse each lithic element in connection with others, and each site as a whole, since each assemblage is subjected to specific, exceptional circumstances. Only upon understanding each collection after comparing the different categories it comprises, it is possible to elaborate conclusions that can subsequently be extrapolated and compared to the facts documented in other sites. This work contains constant references to the terms Oldowan and Acheulean. The Oldowan was defined precisely in Olduvai, therefore this location is the perfect setting for the justification of the term. In fact, the term Oldowan has well-defined chronological and cultural connotations, whilst Mode 1 defined by Grahame Clark (1969) has, over recent years, been used without enough precision. The same occurs with the Acheulean, which will predominate herein over the term Mode 2, and which also presents specific technological, chronological and cultural features. One of the key goals this work establishes is precisely to define the attributes that characterise the Oldowan and the Acheulean, and to attempt to understand the technological and cultural connotations this differentiation entails. Therefore it is essential that this dichotomy exists explicitly in our discourse. In the first chapter we will expound some general notions on the historiography of the Olduvai expeditions, the stratigraphy, the radiometric and paleo-ecological framework, the archaeological sequence Leakey defined, and the methodology employed in our re-examination. By doing so, we aim to create a suitable contextual framework in which to develop the technological study. As regards all other matters, the index of this work respects a diachronic structure, starting with the oldest sites in Bed I and moving through the archaeological sequence to the top of Bed II, the chronological limit for our research. After presenting a systematic description of each site in its corresponding chapter, general conclusions that summarise and present a global interpretation of the Olduvai sequence appear at the end of the monograph. Our goal is to combine a systematic study of the lithic reduction methods and chaînes opératoires, with a vaster vision that integrates these technical systems in the general framework of the land-use by hominids. We assume that the manufacturing of any stone tool is the result of a series of technical, economic, social and symbolic options that can be encompassed under the term strategies (Perlès 1992:225). From this general perspective, in this work we will attempt to understand the technological strategies used by the humans that lived in Olduvai during the Lower Pleistocene. (The authors).
-
Essai sur une paléoanthropologie solutréenne par Marc TIFFAGOM
Délaissée durant plusieurs décennies par les préhistoriens, la civilisation solutréenne a recouvré son intérêt vers la fin des années 80 grâce à l’essor des approches technologiques, donnant lieu à la publication de quelques travaux précurseurs dans ce domaine en France et au Portugal. L’étude qui est proposée dans ce livre s’inscrit dans la lignée de ces travaux. Elle a d’ailleurs pour cadre l’Espagne, et plus précisément le territoire compris entre Valencia et Cadix, qui correspond à la zone d’extension du “Solutréen de faciès ibérique”. Une entité typologique qui constitue un champ de recherche idéal pour comprendre les mécanismes à l’œuvre dans la construction des identités culturelles solutréennes. D’une part, parce qu’elle est largement éprouvée sur un plan géographique et chrono-stratigraphique, interprétée comme un processus de “régionalisation” et de “désolutréanisation” des industries: le premier afin d’expliquer l’absence de la pointe à ailerons et à pédoncule en Catalogne et en Cantabrie; le second, l’amenuisement progressif, durant près de trois mille ans tout de même (19500-16500 BP), des caractères solutréens. D’autre part, parce que ses célèbres “pointes de flèche” de facture néolithique et ses pointes à cran méditerranéennes évoquent de possibles contacts avec le nord-ouest de l’Afrique et le sud-est de la France, respectivement, d’après les très fortes affinités typologiques que ces deux armatures entretiennent avec les pointes marocaines/pseudo-sahariennes de l’Atérien récent et les pointes à cran du Salpêtrien ancien. Des contacts paléolithiques entre l’Europe et l’Afrique, via le détroit de Gibraltar, ont-ils été établis ? Une “province méditerranéenne”, au sens géographique et/ou culturel du terme, constituée de petits “no man’s land” et qui reliait en permanence le sud de l’Espagne au sud de la France a-t-elle existée ?
Les questions ici s’enchaînent, cruciales pour saisir le sens de l’évolution de ces sociétés paléolithiques. Or seule une définition paléohistorique et paléoanthropologique de ce concept unificateur permettra d’y répondre: qu’en est-il exactement de l’unité culturelle de ce faciès, dans le temps et dans l’espace ? Et ses origines, quelles sont-elles: européennes et africaines ? Menée dans le cadre d’une recherche doctorale, une enquête technologique sur les industries lithiques du site fondateur de cette entité, la Cova del Parpalló, dans la région de Valencia, est venue apporter des premiers éléments de réponse à ces questions. En révélant la présence d’un mode de débitage identique à celui de l’Atérien, le débitage Levallois en l’occurrence, associé de surcroît à la fabrication des pointes à ailerons et à pédoncule, et, surtout, car c’est là son apport principal, de structures a priori hybrides dont les Solutréens seuls peuvent être les auteurs, cette enquête a permis de renforcer respectivement l’idée d’une origine africaine de ce faciès et son unité culturelle dans le temps. Bien plus, le modèle proposé, une évolution interne du Solutréen supérieur de faciès ibérique en trois phases théoriques, trouverait son explication dans l’existence d’une “chaîne de sociétés” (la “province méditerranéenne”) reliant le nord de l’Italie au sud de l’Espagne, rendue possible par la régression marine du Dernier Maximum Glaciaire et qui assurait la diffusion somme toute rapide à cette époque des nouvelles idées techniques: une sorte d’emprunt “à distance”.
-
Contribution à l’étude du Rubané du Nord-Ouest européen
par Anne HAUZEUR
L’occupation rubanée au Grand-Duché de Luxembourg se situe dans le bassin de la moyenne vallée de la Moselle et fait partie de la province stylistique du Rubané du Nord-Ouest. Les sites sont surtout installés sur la basse terrasse mosellane et sur le plateau du Gutland. Quatre d’entre eux ont été fouillés et ont révélé des occupations étalées sur l’ensemble du Rubané récent (IIa-IId), principalement au IIc-IId. Division interne bipartite et présence d’une tranchée de fondation caractérisent les maisons, essentiellement de plan rectangulaire. L’organisation interne des tierces apparaît souvent déstructurée. L’outillage lithique est en majorité importé de la région mosane et atteste de nombreux cycles de remploi. Il est dominé par les pièces esquillées et les armatures. Celles-ci sont souvent asymétriques ou latéralisée à gauche. Le style décoratif de la céramique s’apparente à celui du Rhin moyen, avec un développement de la technique pivotante au peigne à dent multiple et l’utilisation de la bande « vide » en angle associée à un motif annexe. Il témoigne aussi d’affinités avec le style de Leihgestern, la vallée du Neckar et très peu avec le nord du Rubané du Nord-Ouest et le Rubané du Sud-Ouest. De rares motifs décoratifs s’inspirant d’une thématique utilisée dans la culture de Blicquy – Villeneuve-Saint-Germain ou dans le Hinkelstein, ainsi que quelques vases de la Céramique du Limbourg et de la céramique d’accompagnement, illustrent les relations avec les autres groupes et les cultures contemporaines.
The Linear Pottery Culture peopled the Great-Duchy of Luxembourg. It is situated in the Middle Mosel valley and forms a part of the North-West Linear Pottery Culture. The great majority of the settlements occurs on the lower terraces of the Mosel river and on the plateau of the Gutland. Four sites have been excavated and revealed assemblages belonging to the Late LPC (IIa-IId), mainly to IIc-IId. The internal bipartite division and the presence of a foundation trench feature the house plans, which are mostly rectangular. The inside organisation of the postholes’rows often appears deconstructed. The greater part of the imported lithic assemblages to the Mosel settlements evidence numerous cycles of reuse. Splinters and arrowheads points dominate. The latter are often either asymmetrical or retouched on their left lateral edge. The pottery decoration pertains to the Middle Rhine stylistic province. It is characterised by the increasing of the pivoting multiple teeth comb technique and the use of angular « empty » band in association with a secondary motif. It gives also evidence of affinities with the Leihgestern group, the Neckar valley, and very few parallels with the North of the North-West LPC and the South-West LPC. Some rare decoration motifs are inspired by characteristic patterns from the Blicquy – Villeneuve-Saint-Germain culture or Hinkelstein. Yet, there are few pots that belong to the Limbourg Pottery and the « Begleitkeramik » illustrating relations with other contemporaneous groups and cultures.
-
par Laurent BRICAULT 1. Jean WINAND, Le voyage d'Ounamon. Index verborum, concordance, relevés grammaticaux, 1987. 2. Jean WINAND, Études de néo-égyptien, 1. La morphologie verbale, 1992. 3. Pierre KOEMOTH, Osiris et les arbres. Contribution à l'étude des arbres sacrés de l'Égypte ancienne, 1994. 4. Juan Carlos MORENA GARCIA, Études sur l'administration, le pouvoir et l'idéologie en Égypte, de l'Ancien au Moyen Empire, 1997. 5. Dimitri LABOURY, La statuaire de Thoutmosis III. Essai d'interprétation d'un portrait royal dans son contexte historique, 1998. 6. Michel MALAISE & Jean WINAND, Grammaire raisonnée de l'égyptien classique, 1999. 7. Laurent BRICAULT, Isis, Dame des flots, 2006.
-
par M.-G. BOUTIER, M.-Th. COUNET, J. LECHANTEUR La terre les plantes et les animaux (1re partie), 187 notices et 92 cartes. L'ouvrage a été couronné du Prix de philologie de la Communauté française de Belgique. Le tome 6 de l'Atlas linguistique de la Wallonie est le premier d'un ensemble de trois volumes (6 à 8, ce dernier paru) portant le titre général: La terre, les plantes et les animaux. Son objet, qu'explicitent les subdivisions de la table des matières, est le suivant: I. La terre et l'eau, la végétation (la terre, sa nature, son relief: notices 1-10; eaux courantes et dormantes: 11-26; la végétation: 27-40); II. Les routes et les chemins (41-53); III. Généralités sur les plantes (l'arbre, ses parties, son aspect, son développement: 54-74; les fleurs, les fruits: 75-100); IV. Espèces d'arbres et d'arbustes; plantes à fruits (espèces cultivées pour leurs fruits: 101-119; espèces à fruits nommés: 120-157; autres arbres et arbrisseaux: 158-173); V. Activités forestières et arboriculture (174-187). Dans ces volumes comme dans les précédents, les rédacteurs se sont attachés à éditer avec le plus de fidélité possible les très riches matériaux rassemblés par Haust et ses continuateurs et à situer tous les mots dans le cadre géohistorique galloroman. Les volumes sont pourvus d'un index des formes, complété d'un index des étymons (procédure initiée dans le volume 8). Dans chacun, une brève introduction présente l'intérêt des volumes pour la dialectologie wallonne et l'histoire du patrimoine de la Wallonie, ainsi que pour la lexicologie historique.
-
Bilan quinquennal 2001-2006, U.I.S.P.P. Commission VIII (Réunion de Lisbonne, sept. 2006) par Pierre NOIRET (éd.) Table des matières
Le Paléolithique supérieur de Géorgie (2001-2005) | Medea Nioradzé L’état des recherches archéologiques sur le Paléolithique supérieur d’Ukraine (2002-2005) | Lioudmila Iakovleva & Igor Sapozhnikov Les recherches sur le Paléolithique supérieur en République Moldave pendant les années 2001-2005 | Ilie A. Borziac Recherches sur le Paléolithique supérieur de Roumanie. Bilan des années 2000-2005 | Vasile Chirica Research on the Upper Palaeolithic in Greece: 2001-2005 | Eugenia Adam Report on the state of art of Upper Palaeolithic in Hungary 2001-2005 | Viola T. Dobosi Research on the Upper Palaeolithic in Slovakia in 2001-2006 | L’ubomira Kaminská Le Paléolithique supérieur dans les Pays Tchèques: fouilles, opinions et publications dans les années 2001-2005 | Martin Oliva Les recherches sur le Paléolithique supérieur en Pologne entre 2002 et 2005 | Janusz K. Kozłowski Le Paléolithique supérieur en Allemagne méridionale (2001-2005) | Harald Floss Le Paléolithique supérieur de Belgique. Recherches 2001-2005 | Marcel Otte & Pierre Noiret Un dernier hiver à Pincevent. Les Magdaléniens du niveau IV0 | Aline Averbouh, Céline Bemilli, Sylvie Beyries, Olivier Bignon, Pierre Bodu, Grégory Debout, Gaëlle Dumarçay, Jim G. Enloe, Delphine Joly, Michèle Julien, Alexandre Lucquin, Ramiro J. March, Michel Orliac, Boris Valentin, Marian Vanhaeren Le gisement badegoulien de Oisy dans la Nièvre au sein du projet collectif de recherche: « Le Paléolithique supérieur ancien au centre et au sud du Bassin parisien » (Pierre Bodu, dir.) | Pierre Bodu Le Paléolithique supérieur de l’Aquitaine nord-occidentale. Bilan quinquennal (2000-2004) | Michel Lenoir Le Paléolithique supérieur des Pyrénées atlantiques au Languedoc méditerranéen (2002-2006) | François Bon & Dominique Sacchi Le Paléolithique supérieur dans la région alpino-padane et dans les Marches (1996-2005) | Alberto Broglio Recherches sur le Paléolithique supérieur en Italie centrale (1996-2005): Ligurie – Toscane – Latium – Abruzzes | Carlo Tozzi The Upper Paleolithic Record in the Asón River Basin, Eastern Cantabria (Spain): Research & Publications, 2000-2005 | Lawrence G. Straus, Manuel González Morales & Miguel A. Fano Martínez M.A. La recherche sur le Paléolithique supérieur dans le NE ibérique: la Catalogne (2001-2005) | Josep Ma Fullola I Pericot Le Paléolithique supérieur du Portugal (2001-2006) | Thierry Aubry & Nuno Ferreira Bicho
-
Exemples de l’Europe et des premières nations en Amérique du Nord avant le contact européen Actes de sessions présentées au Xe congrès annuel de l’Association Européenne des Archéologues (Lyon, 8-11 septembre 2004) par Céline BRESSY, Ariane BURKE, Pierre CHALARD & Hélène Martin (dirs) Table of content
Avant-Propos (Version française – English version) | Céline Bressy, Ariane Burke, Pierre Chalard et Hélène Martin Occupation du territoire et exploitation des matières premières lithiques: présentation et discussion sur la mobilité des groupes humains au Paléolithique Moyen dans le Nord-Est de l’Italie | Guillaume Porraz & Marco Peresani Saisonnalité et prédation au Pech de l’Azé I. Apport de la cémento-chronologie | William Rendu Acquisition et exploitation des silex allochtones au Gravettien : l’exemple de la couche E du gisement des Fieux (Lot, France) | Pierre Chalard, Patricia Guillermin et Marc Jarry The Côa Valley (Portugal). Lithic raw material characterisation and the reconstruction of Upper Palaeolithic settlement patterns | Thierry Aubry & Javier Mangado Les apports de la squelettochronologie en archéologie préhistorique. Quelques exemples | Olivier Le Gall Territoires de chasse paléolithiques : des méthodes d’études à l’application archéologique | Sandrine Costamagno Notes sur les matières premières siliceuses exploitées par les Magdaléniens de la Grotte Gazel (Aude, France) | Mathieu Langlais & Dominique Sacchi Paleoindian ranges in Northeastern North America based on lithic raw materials sourcing | Adrian Burke Raw material resource management during the Epipalaeolithic in North-Eastern Iberia. The site of Gai Rockshelter (Moià, Barcelona) : a case study | Javier Mangado, Manuel Calvo, Jordi Nadal, Alicia Estrada et Pilar Garcia-Argüelles Imported perceptions vs. new realities in the voyaging corridor. Some thoughts on changes in mobility, landscape learning and raw material acquisition in the Eastern Adriatic Early Neolithic | Niels H. Andreasen Early Neolithic pioneer mobility : raw material procurement in layer 58 of the Gardon cave (Ambérieu-en-Bugey, Ain, France) | Jehanne Féblot-Augustins Le matériel de mouture et de broyage au Néolithique final à Chalain et Clairvaux (Jura, France) : matériaux locaux, matériaux exogènes | Annabelle Milleville Head-Smashed-In Buffalo Jump, seasonality and hunting strategies on the Canadian Plains | Brian Kooyman Multiparametric characterization of Southwestern German cherts : application to the study of raw material circulation during Upper Paleolithic period | Céline Bressy & Harald Floss Mobility and Territoriality on the Northwestern Plains of Alberta, Canada: A Phenomenological approach | Gerry Oetelaar Of lithic territories, ancient and modern | Rengert Elburg & Paul Van der Kroft Common concerns in the analysis of lithic raw material exploitation in the Old and New Worlds | Brooke Blades Postface | Marcel Otte
-
par Marcel OTTE & Janusz K. KOZLOWSKITable des matières Remerciements Préface Shanidar Warwasi Yafteh Pa Sangar Eshkaft-e Gavi Shekaft-i Ghad-i Barm-i Shur Sefid Ab Kara Kamar Comparaisons Conclusions Bibliographie
-
par Marcel OTTE, Vasile CHIRICA & Paul HAESAERTS (dir.) Résumé indisponible.
-
Analyse du fonctionnement d’une aire de boucherie soutirée par un réseau karstique par Dominique CLIQUET (dir.) Table des matières Avant-propos | Marcel Otte et François Fichet de Clairfontaine Préface | Yves Coppens Introduction Chapitre 1 : Présentation et découverte du site – Presentation and discovery of the site (Dominique Cliquet, Gilles Hervieu, Pierre-Amaury Hervieu et Jean Barge) Situation et contexte géographique Découverte du site et déroulement de l’intervention Problématique et méthodologie Nature des vestiges Chapitre 2 : Géologie du site – Geology of the site (Olivier Dugué) Cadre géodynamique de l’Europe du nord-ouest au Jurassique moyen Le bassin sédimentaire jurassique normand Historique des études sur les terrains bathoniens du Bessin et de la Campagne de Caen La mise en place de la plate-forme carbonatée armoricaine bathonienne La carrière de Ranville Pour conclure … Chapitre 3 : Contexte géomorphologique du karst – Geomorphological context of the karst (Sylvie Coutard) Rappel du contexte géologique Les dépôts à galets à 43 m NGF Terrasses et karsts dans la vallée de l’Orne Description de la couverture quaternaire Évolution quaternaire du secteur de Ranville et lien avec le remplissage du karst Pour synthétiser… Chapitre 4 : Datation du remplissage du karst effectuée sur dents de mammifères fossiles par la méthode RPE / U-Th combinées – Dating of the karst fill using U-Th/ESR combined methods on fossil mammal teeth (Jean-Jacques Bahain, Giulia Gruppioni, Christophe Falguères et Jean-Michel Dolo) La datation par combinaison des méthodes RPE et U-Th Application aux échantillons de Ranville Conclusion Chapitre 5 : Etude du karst – The karst study (Joël Rodet) Introduction Qu’est-ce que le karst, ses apports à l’archéologie Les phénomènes karstiques de Ranville Conclusion Chapitre 6 : Remplissage du karst – The karst fill (Dominique Cliquet) Etude taphonomique des artefacts lithiques et des vestiges de faune Qu’en est-il du phasage des évènements ? En guise de conclusion Chapitre 7 : La faune – Fauna (Patrick Auguste) Bref historique de l’état des connaissances sur les faunes mammaliennes pléistocènes en Normandie La faune de Ranville : identification et description des taxons Interprétations paléoécologiques et biochronologiques Analyse taphonomique de l’accumulation osseuse de Ranville L’Homme et l’animal à Ranville : acquisition et traitement des ressources animales Ranville : un gisement particulier ou bien un cas récurrent durant le Paléolithique ? Conclusions sur la faune de Ranville Chapitre 8 : Les industries lithiques – The lithic industries (Dominique Cliquet) Les matières premières Méthode d’étude La série « émoussée » ou ensemble A La série « fraîche » ou ensemble B Caractéristiques et signification typo-technologique de l’ensemble B Comparaison entre les ensembles A et B et les deux artefacts collectés en place dans la nappe alluviale L’ensemble B du site de Ranville dans le complexe technologique du Pléistocène moyen récent du Nord de la France Apports de l’étude du mobilier lithique à la détermination de la fonction du site Chapitre 9 : Contribution à l’approche des modes de vie au Pléistocène moyen récent en Europe septentrionale – A contribution to understanding behaviors during the late Middle Pleistocene in Northern Europe (Dominique Cliquet et Patrick Auguste) Constitution et évolution du site L’environnement du site : le milieu Nature et fonction du site Durée d’occupation et saisonnalité Pour une approche du fonctionnement d’un site au sein d’un territoire Qui est l’artisan du site de Ranville ? Planches hors texte Conclusion (Dominique Cliquet, Patrick Auguste, Joël Rodet, Sylvie Coutard, Jean-Jacques Bahain, Giulia Gruppioni, Christophe Falguères,Jean-Michel Dolo, Olivier Dugué, Gilles Hervieu, Pierre-Amaury Hervieu et Jean Barge) Bibliographie Résumés – Abstract Index Liste des auteurs
-
Les grands sites d’habitat préhistorique, évolution des cultures et des paysages par Béatrice SCHMIDER & Annie ROBLIN-JOUVE Table des matières Préface | Marcel Otte Avant-Propos Chapitre 1. Rappel de quelques données sur le cadre physique et naturel du Massif de Fontainebleau (Annie Roblin-Jouve) Le rebord du plateau de Beauce et la cuvette parisienne Dans les formations sédimentaires récentes L’originalité du relief tient aux sables et aux grès Le milieu naturel est tout aussi original L’eau manque Le podsol et la lande, l’originalité biologique Chapitre 2. L’histoire des recherches préhistoriques dans le Massif de Fontainebleau (Béatrice Schmider) La découverte du gisement du Beauregard, à Nemours Extension des prospections et découvertes nouvelles à partir de 1950 Dernières fouilles programmées Chapitre 3. Les grands habitats préhistoriques, en forêt de Fontainebleau, au Paléolithique supérieur (Béatrice Schmider) Répartition régionale Les principaux sites du Massif des Beauregards, à Nemours Le Cirque de la Patrie Le Beauregard Le Deuxième Redan Les Gros-Monts I Les sites préhistoriques autour de Montigny sur Loing Les découvertes anciennes Un gisement de référence : La Pente des Brosses Les sites préhistoriques du Bassin de l’Essonne et de l’Ouest du Massif de Fontainebleau Les habitats du Bassin de l’Essonne Les grottes ornées L’habitat solutréen de Saint-Sulpice de Favières Chapitre 4. Analyse des séquences stratigraphiques et contexte environnemental (Annie Roblin-Jouve) Les données du relief et des formations superficielles L’importance de l’érosion mécanique au cours du Quaternaire Les données de l’archéologie sur la fin des temps glaciaires Les séquences des principaux gisements Le plateau des Beauregards, la séquence la plus complète Le Cirque de La Patrie et le début de la séquence La Pente des Brosses, référence du Gravettien Saint-Sulpice de Favières, le seul gisement du Solutréen Chapitre 5. Chronologie de la fin des temps glaciaires dans le Massif de Fontainebleau et variations du couvert végétal (Annie Roblin-Jouve) Chronologie de la fin des temps glaciaires La mémoire effacée avant 25.000 ans Des oscillations rapides autour de 23.000 ans Le temps des sables éoliens L’établissement des sols au Postglaciaire L’évolution des paysages végétaux La forêt refuge vers 22.000 ans Lande et forêt au Tardiglaciaire La reconquête forestière et l’intervention humaine au Potsglaciaire Conclusion. Le Massif de Fontainebleau dans le cadre régional à la fin des temps glaciaires Bibliographie Résumé – Abstract
-
par Pierre NOIRET Table des matières Préface | Marcel Otte Remerciements Première partie | INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE Chapitre 1 | Présentation générale Chapitre 2 | Historique des recherches paléolithiques en Europe orientale Chapitre 3 | Cadre géographique Chapitre 4 | Cadre chronostratigraphique et paléo-environnemental Chapitre 5 | Cadre culturel Chapitre 6 | Méthodologie Deuxième partie | DOCUMENTATION Chapitre 1 | Mitoc-Malu Galben Chapitre 2 | Brynzeni I Chapitre 3 | Gordineşti I Chapitre 4 | Corpaci Chapitre 5 | Corpaci-Mâs Chapitre 6 | Ripiceni-Izvor Chapitre 7 | Ciuntu Chapitre 8 | Cotu-Miculinţi Chapitre 9 | Crasnaleuca-Stanişte Chapitre 10 | Molodova V Chapitre 11 | Korman IV Chapitre 12 | Babin I Chapitre 13 | Voronovitsa I Chapitre 14 | Cosăuţi Chapitre 15 | Climăuţi I Chapitre 16 | Climăuţi II Chapitre 17 | Raşkov VII Chapitre 18 | Bobuleşti VI Chapitre 19 | Ciutuleşti I Chapitre 20 | Kulychivka Chapitre 21 | Lipa VI Chapitre 22 | Liste des datations radiométriques Planches couleurs hors texte Troisième partie | ANALYSE Chapitre 1 | L’Aurignacien Chapitre 2 | Les ensembles « transitionnels » Chapitre 3 | Le Gravettien Chapitre 4 | L’épigravettien Chapitre 5 | Comparaisons inter-culturelles Chapitre 6 | Comparaisons inter-régionales Quatrième partie | SYNTHÈSE ET CONCLUSION Chapitre 1 | Synthèse paléo-historique Chapitre 2 | Conclusion Chapitre 3 | Résumé Chapitre 4 | Bibliographie Cinquième partie | ANNEXES Annexe 1 | Les espèces animales Annexe 2 | Aurignacien. Densités des NR et NMI pour les quatre espèces principales Annexe 3 | Aurignacien. 1e ACF (abandonnée) Annexe 4 | Aurignacien. 2e ACF (validée) Annexe 5 | Ensemble « transitionnels ». 1e ACF (abandonnée) Annexe 6 | Ensemble « transitionnels ». 2e ACF (validée) Annexe 7 | Gravettien. Densités des NR et NMI pour les sept espèces principales Annexe 8 | Gravettien. 1e ACF (abandonnée) Annexe 9 | Gravettien. 2e ACF (validée) Annexe 10 | Épigravettien. Densités des NR et NMI pour les sept espèces principales Annexe 11 | Épigravettien. 1e ACF (abandonnée) Annexe 12 | Épigravettien. 2e ACF (validée)
-
La longue tradition graphique par Philippe HAMEAU Table des matières I. Présentation II. Les lieux Relief et géologie du massif d’Agnis Les surfaces karstiques de l’Agnis Évolution géologique au Quaternaire La végétation actuelle du massif Le complexe dit des Maigres III. Les occupations du site Stratigraphie Les unités sédimentaires Commentaires L’occupation préhistorique L’environnement végétal Répartition du mobilier archéologique L’industrie lithique taillée L’industrie lithique polie et les galets La céramique Les restes anthropologiques La faune L’industrie osseuse Les nodules de matière colorante Datation La période historique La céramique Les monnaies Le mobilier métallique Des pierres à fusil Datations IV. Les expressions graphiques État de la paroi Les peintures Inventaire Styles et technique Datation Les gravures Styles, technique et datation V. L’abri peint Les espaces Le cadre physique L’éloignement des habitats Le choix du site L’aménagement des lieux L’iconographie Les principes de l’expression schématique Les figures peintes du site Les données du mobilier L’état du mobilier Le débitage des matières siliceuses Le statut des armatures La part du feu Le cas de la faune Les ossements humains La fréquentation du site au Néolithique La compatibilité des fonctions Passage et transformation VI. L’abri gravé Figures et thèmes L’Homme à la palmette L’organisation du panneau La longue tradition graphique Épilogue graphique VII. Regards croisés Planches hors texte Encart 1 Encart 2 Bibliographie
-
par Cyrille BILLARD, Mark GUILLON & Guy VERRON (dirs) Table des matières Liste des auteurs Préambule Introduction Première partie – Le contexte général de l’étude Chapitre 1 – Contexte géographique et archéologique (C. Billard) Le cadre géographique et géologique Le contexte archéologique Les sépultures collectives de la basse vallée de la Seine à la fin du Néolithique La chronologie de la fin du Néolithique à la confluence Seine-Eure Chapitre 2 – Problématiques générales et objectifs (C. Billard, M. Guillon, S. Piéra, F. Sunder & C. Tirran) Chronologie Évolution architecturale et évolution des pratiques funéraires Biologie et recrutement des populations inhumées Statut des différents sites sépulcraux, modalités des échanges mobiliers Le phénomène campaniforme Chapitre 3 – Méthodes d’étude d’un ensemble de sépultures collectives (M. Guillon, C. Billard, F. Houët†, S. Piéra, M. Sansilbano-Collilieux, C. Tirran & G. Verron) Archéologie funéraire et analyse des vestiges osseux Méthodes de fouille, enregistrement de terrain Enregistrement et traitement de l’information Dénombrement et biologie des populations inhumées Étude du fonctionnement des dépôts sépulcraux Paléopathologie Méthodes d’analyse comparative des données biologiques Le mobilier funéraire Une intégration des données biologiques et culturelles est-elle possible ? Deuxième partie – Étude monographique des sépultures collectives néolithiques de Val-de-Reuil et Porte-Joie Chapitre 1 – La sépulture collective de Porte-Joie « Sépulture 1 » (G. Verron, C. Billard, M. Guillon, F. Sunder, C. Tirran & F. Carré) Circonstances de la découverte et déroulement de la fouille Archéologie funéraire et première approche du recrutement Mobilier funéraire et chronologie Les occupations post-néolithiques Une sépulture de l’âge du Bronze final Influence de la Sépulture 1 sur l’organisation de l’occupation à l’âge du Fer Bilan Chapitre 2 – La sépulture collective de Porte-Joie « Fosse XIV » (G. Verron, C. Billard, M. Guillon, C. Tirran & F. Carré) Circonstances de la découverte et déroulement de la fouille Archéologie funéraire et première approche du recrutement Mobilier funéraire et chronologie Les occupations post-néolithiques L’âge du Bronze – les âges du Fer La période gallo-romaine Le haut Moyen Âge Le Moyen Âge et la période moderne Remaniements du mégalithe Bilan Chapitre 3 – La sépulture collective de Val-de-Reuil « Les Varennes » (C. Billard, R.-M. Arbogast, M. Guillon, S. Piéra, F. Sunder & C. Tirran) Archéologie funéraire et première approche du recrutement Mobilier funéraire et chronologie Chapitre 4 – La sépulture collective de Val-de-Reuil « Beausoleil 3 » (C. Billard, M. Guillon & F. Carré) Circonstances de la découverte et déroulement de la fouille Archéologie funéraire Mobilier funéraire et chronologie Les occupations post-néolithiques Le monument au cours de la protohistoire récente Les sépultures du haut Moyen Âge Les 2 fossés Une fréquentation médiévale et moderne du site Bilan Chapitre 5 – La sépulture collective de Val-de-Reuil « La Butte Saint-Cyr » (C. Billard, M. Guillon, S. Piera & C. Tirran, avec les contributions de R.-M. Arbogast, S. Bailon, F. Carré, G. Léon, F. Leugé & F. Sunder) Circonstances de la découverte et déroulement de la fouille Stratigraphie et architecture : première esquisse Mobilier funéraire et chronologie Les dépôts sépulcraux Première approche du recrutement : décompte et Nombre Minimal d’Individus (N.M.I.) Les liaisons osseuses La conservation des restes dentaires et crâniens Représentation des ossements dans les structures des phases 1 et 2 Les restes de faune : mammifères, oiseaux, poissons, amphibiens et reptiles) (R.-M. Arbogast, S. Bailon & F. Leugé) Bilan sur la dynamique des dépôts Les occupations historiques : chronologie détaillée des perturbations (F. Carré) Un remaniement durant l’Antiquité ? Rôle et transformations de la sépulture collective durant le haut Moyen Âge Après le XIVe s Bilan Troisième partie – Les sépultures collectives de Val-de-Reuil et Porte-Joie : synthèse générale Chapitre 1 – Topographie et organisation générale des monuments (C. Billard & G. Verron) Chapitre 2 – Les caractères architecturaux et le fonctionnement funéraire (C. Billard, M. Guillon, S. Piéra, F. Sunder, C.Tirran & G.Verron) Chapitre 3 – Le mobilier funéraire (C. Billard, G. Querré, L. Salanova & G. Verron, avec la collaboration de R.-M. Arbogast, J.-R. Bourhis, J. L’Helgouac’h†, C.-T. Leroux & C. Du Gardin) Approche globale du mobilier Les grandes catégories Caractères généraux du mobilier : techniques, formes, éléments de comparaison, datation Composition de l’assemblage funéraire, position chronologique, comparaisons culturelles Les matériaux utilisés Approche comparative inter-sites Comparaisons des mobiliers L’évolution des pratiques funéraires du point de vue des dépôts mobiliers La répartition des mobiliers funéraires Datations radiocarbones et bilan sur la chronologie des dépôts mobiliers Datations radiocarbones Conséquences sur les modalités d’utilisation des caveaux après le Néolithique récent Bilan général sur les dépôts mobiliers Le mobilier en tant que marqueur de différences économiques ou sociales Le mobilier en tant que témoin d’une individualisation des dépôts funéraires Le statut du mobilier campaniforme : les relations entre les sépultures collectives et les autres sites campaniformes contemporains de la Boucle du Vaudreuil Les productions céramiques : relations entre le mobilier des sépultures et le mobilier des habitats Discussion Chapitre 4 – Les populations inhumées : recrutement et biologie (M. Guillon, F. Houët†, S. Piéra, M. Sansilbano-Collilieux, F. Sunder, C. Tirran & C. Billard) Recrutement et démographie Les caractères discrets Exploitation statistique des données osseuses Les données paléopathologiques : apports et limites (M. Sansilbano-Collilieux) Paléopathologie dentaire Pathologie osseuse Chapitre 5 – L’apport des études de faune (R.-M. Arbogast) Chapitre 6 – La place des monuments dans l’environnement post-néolithique (F. Carré & C. Treffort, avec la collaboration de C. Billard, M. Guillon & G. Verron) L’âge du Bronze : une pérennité de certains espaces funéraires ? L’âge du Fer : un ancrage spatial en fonction des sépultures collectives ? L’Antiquité : des traces diffuses La période mérovingienne : impact des monuments néolithiques sur l’implantation des espaces funéraires La fin de la période mérovingienne : lien entre le mégalithe de la Butte Saint-Cyr et l’église Sainte-Cécile La période carolingienne : récupération de blocs du monument de la Butte Saint-Cyr pour des travaux dans l’église Une chronologie de la disparition des mégalithes Chapitre 7 – Bilan synthétique Variabilité par champs d’étude Le champ chronologique Le champ de l’architecture et des gestes funéraires Le champ du recrutement de la population inhumée Le champ des modes de vie Approche de la variabilité multi-champs : quelles sépultures, pour quel groupe social, pour quel territoire ? Le groupe humain dans son territoire et sa représentativité Variabilité du projet architectural Des monuments évolutifs Variabilité du statut À quelle entité sociale ont pu se rattacher les différents caveaux ? Conclusion Bibliographie générale Annexes Résumé Summary
-
par Adrian DOBOS, Andrei SOFICARU & Erik TRINKAUS Table of Content Chapter 1 | Introduction Chapter 2 | The Peştera Muierii: geological context and chronology Chapter 3 | A history of investigations at the Peştera Muierii Chapter 4 | The vertabrate paleontological remains Chapter 5 | The Paleolithic assemblages Chapter 6 | The Holocene archeological remains Chapter 7 | The Pleistocene human remains Chapter 8 | The Holocene human skeleton from the Galeria Principală Chapter 9 | Paleonthropological implications of the Peştera Muierii Chapter 10 | References
-
par E. BAIWIR Famille, vie et relations sociales, 160 notices et 66 cartes. L'ouvrage a reçu les Prix de Philologie du Conseil des langues régionales endogènes 2009 de la Communauté Wallonie-Bruxelles; Prix Élisée Legros; Prix Joseph Houziaux de l'Académie royale de Belgique. Le tome 17 de l'Atlas linguistique de la Wallonie est le premier d'un diptyque examinant la vie en société. Il s'organise comme suit: - la famille (1-55); - l'organisation géographique de l'habitat (56-66); - le travail et l’économie (67-81); - les relations amicales (82-93); - les autres interactions humaines (94-160). Dans ces volumes comme dans les précédents, les rédacteurs se sont attachés à éditer avec le plus de fidélité possible les très riches matériaux rassemblés par Haust et ses continuateurs et à situer tous les mots dans le cadre géohistorique galloroman. Les volumes sont pourvus d'un index des formes, complété d'un index des étymons (procédure initiée dans le volume 8). Dans chacun, une brève introduction présente l'intérêt des volumes pour la dialectologie wallonne et l'histoire du patrimoine de la Wallonie, ainsi que pour la lexicologie historique.
-
Profil socio-littéraire et capital relationnel dans l’entre-deux-guerres en Belgique francophone par Björn-Olav DOZO
Qui sont les écrivains belges francophones de l’entre-deux-guerres ? De quoi vivent-ils ? Que publient-ils ? Chez quels éditeurs ? Dans quelles revues ? Sont-ils isolés, entièrement dédiés à leurs œuvres ? Prennent-ils part à une vie littéraire fondée sur des logiques d’opposition de groupes, comme en France ? Peut-on dégager des profils-types ? Existe-t-il des écrivains sans œuvre ? Quel est leur rôle spécifique ?
Ce livre aborde ces questions à partir d’une approche socio-statistique et relationnelle. Celle-ci met en évidence l’importance, pour les auteurs belges, de s’inscrire dans un réseau de relations afin d’exister comme écrivain. L’approche permet également de souligner la rupture socio-professionnelle qui a lieu après la Première Guerre, entre la génération symboliste et les entrants en littérature, qui renouvellent esthétiques et thématiques. Le livre dresse enfin un panorama de la vie littéraire de l’époque, en situant les grands parmi les minores et en interrogeant ce que retient l’histoire littéraire. Mais au-delà du cas belge, l’ouvrage propose une réflexion sur la construction d’une étude quantitative socio-historique de la littérature, sur ses enjeux et sur ses modes opératoires. Comment définir un corpus ? Comment choisir et construire des variables descriptives ? Comment interpréter des résultats graphiques ? Cette étude en acte offre des solutions pragmatiques sans ignorer les questionnements épistémologiques qui sous-tendent ce type d’approche.
Björn-Olav DOZO est chargé de recherches du F.R.S.-F.N.R.S. à l’Université de Liège. Après un séjour postdoctoral au Québec, à l’Université de Montréal et à l’Université de Sherbrooke, il étudie à présent les prix et les animateurs de la vie littéraire. Co-fondateur et co-directeur (2006-2011) de COnTEXTES. Revue de sociologie de la littérature, il s’est spécialisé dans les digital humanities. En 2010, il a publié La vie littéraire à la toise aux éditions Le Cri (Bruxelles).
-
par Jean-Marie LE TENSORER, Reto JAGHER & Marcel OTTE (eds.) Table of content The Core-and-Flake Industry of Bizat Ruhama, Israel: Assessing Early Pleistocene Cultural Affinities | Yossi Zaidner New Acheulian Locality North of Gesher Benot Ya´aqov – Contribution to the Study of the Levantine Acheulian | Gonen Sharon The Lower Palaeolithic in Syria | Sultan Muhesen & Reto Jagher Innovative human behavior between Acheulian and Mousterian: A view from Qesem Cave, Israel | Ran Barkai & Avi Gopher The Mugharan Tradition Reconsidered | Avraham Ronen, Izak Gisis & Ivan Tchernov Recent progress in Lower and Middle Palaeolithic research at Dederiyeh cave, northwest Syria | Yoshihiro Nishiaki, Yosef Kanjo, Sultan Muhesen & Takeru Akazawa Le Yabroudien en Syrie : état de la question et enjeux de la recherche | Amjad Al Qadi The contribution of Hayonim cave assemblages to the understanding of the so-called Early Levantine Mousterian | Liliane Meignen Capturing a Moment: Identifying Short-lived Activity Locations in Amud Cave, Israel | Erella Hovers, Ariel Malinsky-Buller, Mae Goder-Goldberger & Ravid Ektshtain Late Levantine Mousterian Spatial Patterns at Landscape and Intrasite Scales in Southern Jordan | Donald O. Henry Levallois points production from eastern Yemen and some comparisons with assemblages from East-Africa, Europe and the Levant | Rémy Crassard & Céline Thiébaut Development of a geospatial database with WebGIS functions for the Paleolithic of the Iranian Plateau | Saman Heydari, Elham Ghasidian, Michael Märker & Nicholas J. Conard The Late Middle Palaeolithic and Early Upper Palaeolithic of the northeastern and eastern edges of the Great Mediterranean (south of Eastern Europe and Levant): any archaeological similarities ? | Yuri E. Demidenko The Archaeology of an Illusion: The Middle-Upper Paleolithic Transition in the Levant | John J. Shea La transition du Moustérien à L’Aurignacien au Zagros | Marcel Otte & Janusz Kozlowski El Kowm, a key area for the Palaeolithic of the Levant in Central Syria | Reto Jagher & Jean-Marie Le Tensorer Nadaouiyeh Aïn Askar – Acheulean variability in the Central Syrian Desert | Reto Jagher The faunal remains from Nadaouiyeh Aïn Askar (Syria). Preliminary indications of animal acquisition in an Acheulean site | Nicole Reynaud Savioz Hummal: a very long Paleolithic sequence in the steppe of central Syria – considerations on Lower Paleolithic and the beginning of Middle Paleolithic | Jean-Marie Le Tensorer, Vera von Falkenstein, Hélène Le Tensorer & Sultan Muhesen Chronometric age estimates for the site of Hummal (El Kowm, Syria) | Daniel Richter, Thomas C. Hauck, Dorota Wojtczak, Jean-Marie Le Tensorer & Sultan Muhesen A Yabroudian Equid skull and upper cheek teeth from the site of Hummal (El Kowm, Syria) | Hani El Suede The Lower Palaeolithic assemblage of Hummal | Fabio Wegmüller A three-dimensional model of the Palaeolithic site of Hummal (Central Syria) | Daniel Schuhmann Hummal (Central Syria) and its Eponymous Industry | Dorota Wojtczak The Mousterian sequence of Hummal and its tentative placement in the Levantine Middle Palaeolithic | Thomas C. Hauck
-
par Michel TOUSSAINT, Kévin DI MODICA & Stéphane PIRSON (dirs) Table des matières Avant-propos | Michel Toussaint Première partie : Marguerite Ulrix-Closset, biographie et hommages Marguerite Ulrix-Closset, vie et oeuvre d’une préhistorienne liégeoise | Michel Toussaint et Kévin Di Modica Marguerite, la mèche au vent | Marcel Otte Lettre de reconnaissance d’un fouilleur à Madame Marguerite Ulrix-Closset | Onhan Tunca Mooie en dankbare herinneringen aan Marguerite Ulrix-Closset | Pierre M. Vermeersch Mine de rien ! Un exemple de filiation académique en archéologie | André Gob Marguerite Ulrix-Closset et les « Chercheurs de laWallonie », un demi-siècle de symbiose | Jules Haeck et Michel Toussaint Marguerite au « Musee de la Prehistoire en Wallonie » | Fernand Collin Marguerite Ulrix-Closset et le Rubané en Belgique | Anne Hauzeur L’enseignement de la Technique des fouilles a l’Université de Liège | Pierre Noiret Deux représentations de la grotte de Spy par le peintre Paul Delvaux | Gaetane Warzée Aspects lithiques des Moustériens en Belgique. Hommage à Madame Marguerite Ulrix- Closset | Marcel Otte Deuxième partie : Le Paléolithique moyen en Belgique, quatre décennies après la thèse de Marguerite Ulrix-Closset La documentation du Paléolithique moyen en Belgique aujourd’hui, état de la question | Kévin Di Modica Position chronostratigraphique des productions lithiques du Paléolithique ancien en Belgique : un état de la question | Stéphane Pirson et Kévin Di Modica Les Néandertaliens du Bassin mosan belge : bilan 2006-2011 | Michel Toussaint, Patrick Semal et Stéphane Pirson The Early Middle Palaeolithic of Belgium | Ann Van Baelen et Caroline Ryssaert Variabilité des systèmes d’acquisition et de production lithique en réponse à une mosaïque d’environnements contrastes dans le Paléolithique moyen de Belgique | Kévin Di Modica Regards sur le Paléolithique moyen de France septentrionale et de Belgique | Jean-Luc Locht et Pascal Depaepe Les productions bifaciales du Paléolithique moyen sur le territoire belge. Présentation d’industries entre deux mondes | Karen Ruebens et Kévin Di Modica Les pointes foliacées et les changements techniques autour de la transition du Paléolithique moyen au supérieur dans le Nord-Ouest de l’Europe | Damien Flas Tool Use and Hafting in theWestern European Middle Palaeolithic | Veerle Rots Troisième partie : Présentation des principaux sites paléolithiques fouillés depuis 1975 Le Paléolithique ancien de La Belle-Roche (Sprimont, province de Liège) | Jean-Marie Cordy Le Trou de l’Abîme à Couvin | Pierre Cattelain, Damien Flas, Rebecca Miller, Marcel Otte, Stéphane Pirson et Michel Toussaint La grotte de Spy (Jemeppe-sur-Sambre ; prov. Namur) | Patrick Semal, Cécile Jungels, Kévin Di Modica, Damien Flas, Anne Hauzeur, Michel Toussaint, Stéphane Pirson, Gennady Khlopachev, Damien Pesesse, Elise Tartar, Isabelle Crèvecoeur, Hélène Rougier et Bruno Maureille La grotte Scladina : bilan 1971-2011 | Dominique Bonjean, Kévin Di Modica, Grégory Abrams, Stéphane Pirson et Marcel Otte Le Trou Al’Wesse : du Moustérien au Néolithique dans la vallee du Hoyoux | Rebecca Miller, Fernand Collin, Marcel Otte et John Stewart Les occupations moustériennes de la grotte Walou (Trooz) | Christelle Draily A Middle Palaeolithic site with small bifaces at Oosthoven−Heieinde (Northern Belgium) | Karen Ruebens et Philip Van Peer Le gisement paléolithique de la Sablière Gritten à Rocourt (province de Liège) | Paul Haesaerts, Kevin Di Modica et Stéphane Pirson Le gisement paléolithique de Remicourt−En Bia Flo I | Dominique Bosquet, Paul Haesaerts, Freddy Damblon, Paula Jardon Giner et Caroline Ryssaert Les sites du Mont Saint-Martin (Liège) | Pierre van der Sloot, Paul Haesaerts et Stéphane Pirson A diachronic perspective on the Palaeolithic occupations at Kesselt−Op de Schans | Ann Van Baelen, Jeanne-Marie Vroomans et Philip Van Peer The Middle Palaeolithic Open-air Sites at Veldwezelt−Hezerwater | Patrick M.M.A. Bringmans Le Paléolithique moyen en Belgique, essai de synthèse | Kévin Di Modica, Stéphane Pirson et Michel Toussaint
-
par Elena MAN-ESTIER Table des matières Introduction Présentation générale de l’étude Ours vu et ours perçu : les clés d’identification Réalisme de la représentation Contexte de la représentation Conclusion Bibliographie Annexes Planches hors texte CD-ROM reprenant le catalogue
-
From Late Middle Paleolithic and Early Upper Paleolithic to Epi-Paleolithic in Crimea. [The Paleolithic of Crimea, IV] par Yuri E. DEMIDENKO, Marcel OTTE & Pierre NOIRET (dirs) Table of content Préface | Foreword | Marcel Otte The history of investigations at Siuren I and different interpretations of the site’s archaeological context | Yuri E. Demidenko Siuren I: excavation strategies and methodologies | Alexandre I. Yevtushenko† Siuren I: Stratigraphic and Archaeological Sequences for the 1990s Excavations | Alexandre I. Yevtushenko† Radiocarbon Dates for the Siuren I sequence | Yuri E. Demidenko & Pierre Noiret Zooarchaeological analysis of the faunal assemblages from Siuren I, Crimea (Ukraine) | Jessica Massé & Marylène Patou-Mathis Small Mammals from Paleolithic Site Siuren I | Anastasia K. Markova Snail Fauna Data from Siuren I | Constantine Mikhailesku The Worked Bone Artifacts from the Siuren I Rock-Shelter (Crimea): the 1990s Excavation | Natalia B. Akhmetgaleeva The Classification and Attribute Analysis System Applied to the Siuren I Lithic Assemblages | Yuri E. Demidenko Unit H: Lithic Artifacts | Yuri E. Demidenko & Victor P. Chabai Unit G: Lithic Artifacts | Yuri E. Demidenko & Victor P. Chabai Unit F: Lithic Artifacts | Yuri E. Demidenko & Victor P. Chabai Unit E-A: Lithic Artifacts | Yuri E. Demidenko Inter-Unit and Inter-Level Comparisons of Assemblages from the 1990s Units H, G and F | Yuri E. Demidenko Comparisons between the Siuren I Assemblages from the 1920s Lower and Middle Layers and the 1990s Units G and F | Yuri E. Demidenko Interpretation of the Middle Paleolithic Component in the Early Aurignacian Units H and G and the 1920s Lower Layer | Yuri E. Demidenko The Problem of Industrial Attribution of Artifacts from the Upper Cultural Bearing Deposits at Siuren I: 1920s Excavations Upper Layer and 1990s Excavations Units E-A | Yuri E. Demidenko The Siuren-I Aurignacian of Krems-Dufour Type Industries in the Context of the European Aurignacian | Yuri E. Demidenko & Pierre Noiret Small Laminar Blanks at Siuren I Rockshelter: Technological & Comparative Approach | Nicolas Zwyns The Siuren I Archaeological Industrial Sequence seen Through the Site’s Human Occupation Events | Yuri E. Demidenko Looking East | Marcel Otte Concluding Considerations | Yuri E. Demidenko Perspectives | Marcel Otte & Pierre Noiret References
-
par Aurélien SIMONET Table des matières Remerciements. Introduction. I. Présentation du site de Brassempouy (Landes, France) : une caverne modeste pour la Joconde de la Préhistoire. Avant-propos. Localisation. Aperçu géologique et topographique. Aperçu historiographique. Orientation de l’étude. II. Les fouilles du XIXe siècle (1880-1881 ; 1891-1897) et la découverte des statuettes féminines. Descriptions stratigraphiques : une séquence quasi-complète du Paléolithique supérieur dans l’Avenue, la grotte du Pape et la Grande Galerie. Les fouilles Dubalen (1880-1881). Les fouilles De Laporterie et Dufour (1890-1892). Les fouilles de l’AFAS (19 septembre 1892). Les fouilles Piette et De Laporterie (1894-1895). Les fouilles Piette et De Laporterie (1896-1897). Synthèse. III. Le chantier I : une zone de rejet en avant de la grotte du Pape. Descriptions stratigraphiques. Présentation de l’assemblage lithique de la couche D du chantier I. Une variété d’armatures lithiques. Des modalités opératoires rapides et unifiées. Une utilisation de matières premières locales. Le chantier I : une zone de rejet d’atelier de taille du silex ? IV. Le secteur GG2 au fond de la grotte du Pape : un dépôt intentionnel d’armes gravettiennes sacrifiées ? Un témoin de la stratigraphie originelle au fond de la grotte du Pape. Présentation du corpus d’étude. L’industrie lithique. L’industrie osseuse. Les données spatiales et taphonomiques. Vers une attribution gravettienne. Réflexion sur la mise en place des dépôts dans le secteur GG2. Un dépôt intentionnel d’armes sacrifiées ? Une conjonction d’éléments particuliers. Un sanctuaire à Brassempouy ? V. Armes et Vénus : vers une paléo-sociologie des gravettiens de Brassempouy. Une seule tradition gravettienne ? Un espace compartimenté : l’exemple-type du campement gravettien à Vénus d’Europe occidentale. Une cohérence régionale à l’échelle pyrénéenne. Une cohérence nationale à l’échelle française. Une trame eurasiatique. VI. De la technologie à l’idéologie. Introduction : l’idéologie comme objectif anthropologique. Un socle conceptuel restreint : l’idéologie trifonctionnelle indo-européenne de G. Dumézil et la bipolarité sexuelle paléolithique de A. Leroi-Gourhan. À la recherche de l’idéologie gravettienne. Sanctuaires armés : de Brassempouy à Lascaux. Conclusion. Epilogue : la métamorphose de Vénus. Bibliographie.
-
suivi de Note sur la structure des paradigmes et de Sur la dualité de la poétique
par Claude ZILBERBERG
Présentation de l'ouvrage
Cet ouvrage est le point d’aboutissement d’une pensée qui, depuis une vingtaine d’années, interroge et travaille l’épistémologie structurale au nom du graduel, du continu, du dynamique, de l’affectif. Il s’agit d’un « structuralisme tensif », qui donne toute sa place à l’ « événement ».
Le présent ouvrage vise à construire, de manière systématique, un véritable édifice théorique actualisé, des fondements jusqu’au dialogue avec des auteurs classiques de la poétique et de la réflexion sur les formes symboliques, tels que Cassirer ou Wölfflin, Hjelmslev ou Mauss, Baudelaire ou Valéry. Un glossaire final permettra au lecteur de s’emparer davantage de cette théorie foisonnante et d’une grande cohérence.
Notice de l’auteur
Claude Zilberberg, né 1938, est l’un des théoriciens essentiels de la sémiotique structurale d’A. J. Greimas, qu’il a renouvelée en imposant ce qu’on appelle aujourd’hui la « sémiotique tensive ». Parmi ses ouvrages : Essai sur les modalités tensives (Hadès-Benjamins, 1981), Raison et poétique du sens (PUF, 1988), Tension et signification (avec J. Fontanille, Mardaga, 1998), Éléments de grammaire tensive (PULIM, 2006), Des formes de vie aux valeurs (PUF, "Formes sémiotiques", 2011).
-
Controverses et propositions
par Claude CALAME et Bruce LINCOLN
Présentation du volume
Comparer les comparables ? Comparer les comparatismes ? Pourquoi et comment comparer ? La première interrogation a été formulée par Emmanuel Lévinas dans le questionnement sur les relations avec autrui; elle a été transférée récemment dans le domaine de l’anthropologie culturelle, et plus particulièrement dans celui de l’histoire des religions. Les doutes entretenus par les grandes entreprises comparatistes, de J.G. Frazer à Cl. Lévi-Strauss en passant par M. Eliade ou G. Dumézil, ont suscité la seconde, plus récemment encore. Quant à la troisième elle est l’objet, pour les religions antiques, des contributions réunies dans le présent volume, dans des tentatives devenues désormais plus modestes et plus expérimentales. En effet, pour l’Antiquité, les principes de l’analyse structurale dans l’anthropologie culturelle et sociale des années 1960 ont conduit soit au paradigme indo-européen des trois fonctions, soit à un renouveau du paradigme sémitique : approche moins diachronique que synchronique dans le premier cas ; fréquente perspective historique de dérivation dans le second. Déconstructionisme et relativisme postmoderniste ont contribué à déstabiliser la belle assurance des oppositions et schémas structuraux. Ils ont montré les risques d’un universalisme et d’un essentialisme naturalisant. Désormais, la démarche comparative est revenue à des pratiques moins ambitieuses, soit sur le mode du questionnement et de l’expérimentation autour d’un problème, soit sur le mode de la comparaison différentielle à la recherche de spécificités définies par contraste, soit encore sur le mode dialogique et réflexif qui est aussi devenu celui de l’anthropologie culturelle et sociale. À l’exemple des phénomènes que nous plaçons sous l’étiquette de la religion, comment réhabiliter une démarche comparative à la fois rigoureuse et critique ? Questionnements donc, à partir d’exemples précis, sur les modèles d’intelligibilité dont nous nous inspirons, dans la dialectique parfois conflictuelle entre catégories « émiques » et catégories « étiques », pour refonder une analyse comparative productive, en histoire des religions en particulier et en sciences humaines en général.
Table des matières
Claude Calame et Bruce Lincoln, Les approches comparatives en histoire des religions antiques : controverses récurrentes et propositions nouvelles
Maurizio Bettini, Vertumnus ou les aphormaí de l’anthropologue classique : approches comparatives et religion romaine
Claude Calame, Comparatisme en histoire anthropologique des religions et regard transversal : le triangle comparatif
Marcel Detienne, Entrer en religion et comparer
Page duBois, Thirty-six Views of Mytilene: Comparative Approaches to Ancient Lesbos
David Frankfurter, Comparison and the Study of Religions of Late Antiquity
Bruce Lincoln, Theses on Comparison
John Scheid, L’oubli du comparatisme dans certaines approches récentes des religions antiques
Notice des éditeurs
Claude CALAME, anthropologue et historien de l’Antiquité, spécialiste des poétiques grecques, est directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris où il est membre du Centre AnHiMA (Anthropologie et Histoire des Mondes Anciens) et du CRAL (Centre de Recherche sur Arts et la Littérature).
Bruce LINCOLN, spécialiste en histoire comparée des religions antiques, est Caroline E. Haskell Professor of the History of Religions à la Divinity School de l’Université de Chicago où il est associé aux Départements d’Anthropologie et de Classics, et membre du Center for Middle Eastern Studies and Committee on Medieval Studies.
-
Des chasseurs de rennes en Quercy par Jean CLOTTES, Jean-Pierre GIRAUD & Pierre CHALARD (dir.) Table des matières
Préface | Jacques Jaubert, Michel Barbaza & Michel Vaginay Avant-propos | Jean Clottes, Jean-Pierre Giraud & Pierre Chalard Historique des recherches : la découverte, la fouille et l’étude | Jean Clottes & Jean-Pierre Giraud Le cadre naturel | Guy Astruc & Laurent Bruxelles Lithostratigraphie, dynamique sédimentaire et implications | Bertrand Kervazo & Stéphane Konik Les micromammifères | Emmanuel Desclaux Le cadre chronologique : datations 14C | Christine Oberlin & Hélène Valladas Les industries lithiques du Solutréen Pierre Chalard, André Morala & Alain Turq, Pétroarchéologie du silex Christian Servelle, Les autres roches Caroline Renard, L’organisation des productions en silex, implications techno-économiques Les industries lithiques du Badegoulien Pierre Chalard, André Morala & Alain Turq, Pétroarchéologie du silex Christian Servelle, Les autres roches Jean Clottes, Carole Fritz, Jean-Pierre Giraud & Christian Servelle, Les galets portant des traces d’utilisation Sylvain Ducasse & Laure-Amélie Lelouvier, Techno-économie des équipements en silex, une première approche diachronique L’art mobilier : le galet gravé badegoulien | Jean Clottes, Carole Fritz, Jean-Pierre Giraud, Christian Servelle Les colorants | Marie-Pierre Pomiès & Colette Vignaud Archéozoologie | Jean-Christophe Castel Analyse cémentochronologique | Hélène Martin & Olivier Le Gall, avec la collaboration de Bernard Martin Premier regard sur la matière dure animale ouvragée | Yanik Le Guillou Les coquillages | Yvette Taborin Le travail du bois de renne dans les couches badegouliennes | Jean-Marc Pétillon & Aline Averbouh Les vestiges humains : deux exemples de traitement du cadavre | Dominique Henri-Gambier & Sébastien Villotte Structures d’habitat et organisation de l’espace | Nathalie Fourment & Jean-Pierre Giraud De 20 000 à 18 000 BP en Quercy : Apports de la séquence du Cuzoul de Vers à la compréhension de l’évolution des comportements socio-économiques entre Solutréen et Badegoulien | Sylvain Ducasse & Caroline Renard
avec la collaboration de Guy Astruc, Aline Averbouh, Laurent Bruxelles, Jean-Christophe Castel, Pierre Chalard, Jean Clottes, Emmanuel Desclaux, Nathalie Fourment, Carole Fritz, Jean-Pierre Giraud, Dominique Henri-Gambier, Bertrand Kervazo, Stéphane Konik, Olivier Le Gall, Yanik Le Guillou, Laure-Amélie Lelouvier, Bertrand Martin, Hélène Martin, André Morala, Christine Oberlin, Jean-Marc Pétillon, Marie-Pierre Pomiès, Christian Servelle, Yvette Taborin, Alain Turq, Hélène Valladas, Colette Vignaud, Sébastien Villotte
Bibliographie -
par Marcel OTTE, Sonia SHIDRANG, Damien FLAS (eds)
Table of content
Remerciements Introduction | M. Otte & S. Shidrang The 1960s excavations at Yafteh Cave | F. Hole The Baradostian Sequence of Yafteh cave A typo-technological lithic analysis based on the Hole and Flannery collection | J.-G. Bordes & S. Shidrang Les fouilles 2005-2008 à Yafteh et la chronologie radiocarbone | N. Zwyns, D. Flas, S. Shidrang & M. Otte Les vestiges techniques en pierre taillée | M. Otte The Upper Paleolithic faunal remains from Yafteh cave (central Zagros), 2005 campaign. A preliminary study | M. Mashkour, V. Radu, A. Mohased & J. Darvish The Earlier Upper Palaeolithic: A View from the Southern Levant | A. Belfer-Cohen & N. Goring-Morris The Early Upper Paleolithic of the Caucasus in the West Eurasian Context | L.V. Golovanova & V.B. Doronichev Conclusion | M. Otte
-
avec une introduction grammaticale et une liste des mots présentés selon le classificateur sémantique par Jean WINAND et Alessandro STELLA avec la collaboration de Laurence NEVEN Présentation du volume
À côté des dictionnaires généraux qui embrassent plusieurs états de la langue égyptienne, comme le classique Wörterbuch der ägyptischen Sprache d’Erman et Grapow ou le Großes Handwörterbuch de Hannig, on déplore l’absence d’outils modernes dont le premier public sont les étudiants qui commencent l’étude de la langue égyptienne.
Le volume qui est présenté ici est un lexique moyen égyptien – français. Son but avoué est d’abord de rendre service aux étudiants qui entament un premier cycle d’étude en moyen égyptien. Ce n’est donc pas un dictionnaire scientifique de référence. Son ambition est limitée : d’abord par le nombre de mots retenus (env. 2500), ensuite par le nombre restreint de renseignements qu’il contient. Le lecteur trouvera pour chaque mot une graphie, jugée la plus représentative, la transcription, l’appartenance à une classe de mots, et une traduction standard. On retiendra toutefois deux innovations majeures : d’abord, le regroupement des mots en fonction de la racine ; ensuite, une liste des mots classés en fonction du classificateur sémantique.
Le corpus considéré est, en gros, l’égyptien classique (textes littéraires et textes d’affichage) et le moyen égyptien (textes de la pratique). L’ère chronologique couverte va de la Première Période Intermédiaire jusqu’à la xviiie dynastie. En préambule, le lecteur trouvera une présentation générale, volontairement réduite, de l’écriture hiéroglyphique, de l’histoire de la langue égyptienne, de la formation des mots, et un aperçu synthétique de la grammaire de l’égyptien classique.
Notice des auteurs
Jean WINAND est professeur ordinaire à l’Université de Liège et Doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres. Ses domaines de recherche sont la langue et la philologie de l’Égypte ancienne. Il a publié, entre autres, Études de néo-égyptien. La morphologie verbale (1992), Grammaire raisonnée de l’Égyptien classique (1999, avec Michel Malaise), Temps et Aspect en égyptien. Pour une approche sémantique (2006).
Alessandro STELLA est doctorant à l’Université de Liège, où il étudie les verbes de perception visuelle en égyptien ancien selon une perspective diachronique. Ses domaines de recherche sont la lexicologie, la lexicographie, la sémantique lexicale et la philologie.
-
L’apporto della Papirologia alla Storia della Tradizione Virgiliana (I – VI d.C.) par Maria Chiara SCAPPATICCIO Présentation du volume
Papyri Vergilianae rappresenta una novità el campo della filologia e della papirologia latina: si tratta della prima raccolta completa ed esaustiva dei papiri di Virgilio, frutto di acribia ecdotica e dell’esame autoptico dei testi, che vengono analiticamente schedati e di cui è data l’edizione critica. Si propone come strumento per un approccio filologico alle trentacinque testimonianze papiracee – inclusi frammenti membranacei, tavolette lignee ed ostraka – che, provenienti dalle province eccentriche dell’Impero (ed in particolare dalla pars Orientis), costituiscono parte della ‘Storia della Tradizione’ in quanto espressione della ricezione dell’opera di Virgilio e segno di una funzione ed una circolazione differenziata nei milieux culturali ed intellettuali provinciali tra I e VI secolo d.C. Il nucleo del volume è costituito dalla schedatura analitica dei documenti e da un’edizione dei loro testi ‘a fronte’ rispetto a quella virgiliana nota dal resto della tradizione manoscritta in base ad un’edizione critica di riferimento (rispettivamente ‘Parte Seconda’ e ‘Parte Terza’), incorniciate da un’introduzione (‘Parte Prima’) ed una sezione contenente testi che, pur non essendo esametri virgiliani, ne documentano parimenti la fortuna (‘Parte Quarta’).
Notice de l'auteurMaria Chiara SCAPPATICCIO, dottore di ricerca presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane dal 2011, dopo aver terminato il mandato postdottorale al CEDOPAL dell’Université de Liège, è ora assegnista del Dipartimento di Filologia Classica ‘F. Arnaldi’ dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’. È autrice di numerosi articoli sul ruolo dei testimoni letterari latini su papiro e sul loro contributo alla critica del testo (si ricordino gli studi sul carme De bello Actiaco del PHerc. 817, oltre quelli sui papiri virgiliani) nonché di un volume sulla tradizione grammaticale latina nella Tarda Antichità dal titolo “Accentus, distinctio, apex. L’accentazione grafica tra Grammatici Latini e papiri virgiliani”, Turnhout 2012 (Brepols).
-
Perspectives croisées et représentations par Pierre BONNECHERE & Renaud GAGNÉ Présentation du volume
Le thème du sacrifice humain ne peut laisser indifférent et continue de susciter bien des interrogations, entre fascination et dégoût. Historiens et anthropologues se divisent sur l’historicité supposée du phénomène. Pour sortir de l’impasse, cet ouvrage se penche sur la manière dont les cultures se représentent le sacrifice humain, le leur ou celui des autres, fût-il réel ou symbolique. Comment une société fait-elle face à ce qui est – ou ce qu’elle croit être – son passé cruel et sanglant ? Quelles sont les valeurs dont le sacrifice humain, et d’autres concepts proches, comme l’anthropophagie, se trouvent chargés en vertu des normes indigènes ? Comment ces perceptions ont-elles persisté dans la longue durée et comment se sont-elles adaptées aux idéologies changeantes ? Le cœur du volume est consacré au dossier hellénique, remarquablement documenté par les Grecs eux-mêmes. À ce dossier répondent en contrepoint plusieurs articles sur la Chine ancienne, les Aztèques, et la Rome antique, qui projettent un regard différent et sont autant de raisons de remettre cent fois sur le métier cet objet fascinant.
Table des matières
Pierre BONNECHERE, Renaud GAGNÉ Introduction. Le sacrifice humain : un phénomène au fil d’Ariane évanescent
Pierre BONNECHERE Victime humaine et absolue perfection dans la mentalité grecque
Joannis MYLONOPOULOS Gory Details? The Iconography of Human Sacrifice in Greek Art
Jan N. BREMMER Human Sacrifice in Euripides’ Iphigenia in Tauris: Greek and Barbarian
Renaud GAGNÉ Athamas and Zeus Laphystios: Herodotus 7.197
Albert HENRICHS Répandre le sang sur l’autel : ritualisation de la violence dans le sacrifice grec
Robert C.T. PARKER Substitution in Greek Sacrifice
Robin D.S. YATES Human Sacrifice and the Rituals of War in Early China
Griet VANKEERBERGHEN “Yellow Bird” and the Discourse of Retainer Sacrifice in China
Louise I. PARADIS La représentation des sacrifices humains par les Aztèques et les Espagnols : une image vaut mille mots
Bill GLADHILL The Poetics of Human Sacrifice in Vergil’s Aeneid
Notice des éditeurs
Pierre BONNECHERE, spécialiste de la religion et des mentalités grecques, enseigne l’histoire grecque au Département d’Histoire de l’Université de Montréal. Ses thèmes de prédilection sont le sacrifice et la divination, ainsi que l’histoire des jardins.
Renaud GAGNÉ, a specialist of early Greek poetry and religion, teaches Greek literature in the Faculty of Classics at the University of Cambridge. He is a co-editor of Choral Mediations in Greek Tragedy (2013) and the author of Ancestral Fault in Ancient Greece (2013).
-
l’apport des papyrus latins par Marie-Hélène MARGANNE et Bruno ROCHETTE (éds) Présentation du volume
Bien moins nombreux que les papyrus grecs, les papyrus latins présentent néanmoins un grand intérêt pour l’étude des contacts entre les deux langues officielles du bassin méditerranéen antique, à savoir le grec et le latin. Ces contacts se manifestent non seulement par l’existence de papyrus bilingues, mais sont aussi perceptibles à d’autres niveaux : les emprunts lexicaux dans les papyrus documentaires et l’influence d’une écriture sur l’autre. Ces aspects ont été fortement renouvelés ces dernières années, mais n’ont pas fait l’objet d’une réflexion plus globale sur les phénomènes inter-linguistiques en Egypte gréco-romaine. La Table Ronde organisée à Liège les 12 et 13 mai 2011 a voulu proposer des pistes de réflexion sur cette thématique. Elle souhaitait aussi faire le bilan des avancées récentes de la papyrologie latine en prenant en considération deux phénomènes étroitement liés, le bilinguisme et le digraphisme. Cette synthèse doit permettre de mesurer les progrès de la recherche dans ce domaine et de donner une impulsion à la mise à jour du Corpus des papyrus latins de Robert Cavenaile, lequel date de 1958.
Table des matières Bruno Rochette Papyrologie latine et bilinguisme gréco-latin : des perspectives nouvelles Marie-Hélène Marganne Le CEDOPAL et les papyrus latins : pour une mise à jour du Corpus Papyrorum Latinarum de Robert Cavenaile Alain Martin Réflexions d’un bibliographe Nathan Carlig Une bibliographie critique relative au bilinguisme grec-latin Johannes Kramer Les glossaires bilingues sur papyrus Paolo Radiciotti (Ϯ) Digrafismo nei papiri latini Marco Fressura Tipologia del glossario virgiliano Maria Chiara Scappaticcio Lectio bilingue, bilinguismo della lectio. Sull’accentuazione grafica nei papiri latini: sondaggi dai PNess. II 1 e 2 Gabriel Nocchi Macedo Bilinguisme, digraphisme, multiculturalisme : une étude du Codex Miscellaneus de Montserrat Hilla Halla-aho Bilingualism in Action: Observations on Document Type, Language Choice and Greek Interference in Latin Documents and Letters on Papyri Notices des éditeurs Marie-Hélène MARGANNE est Directrice du Centre de Documentation de Papyrologie Littéraire (CEDOPAL) de l’Université de Liège où elle enseigne la papyrologie littéraire et la paléographie grecque. À la fois papyrologue et historienne de la médecine, elle est l’auteur de nombreuses publications sur les papyrus médicaux, le livre et les bibliothèques antiques. Bruno ROCHETTE est Professeur de langues et littératures classiques à l’Université de Liège et Président du Comité de gestion du Centre de Documentation de Papyrologie Littéraire (CEDOPAL). Ses recherches sont consacrées au bilinguisme gréco-latin. -
Selected papers from the meeting of the Computer Working Group of the International Association of Egyptologists (Informatique & Égyptologie), Liège, 6-8 July 2010 par Stéphane POLIS et Jean WINAND with the collaboration of Todd GILLEN Présentation du volume
This volume represents the outcome of the meeting of the Computer Working Group of the International Association of Egyptologists (Informatique & Égyptologie) held in Liège in 2010 (6-8 July) under the auspices of the Ramses Project. The papers are based on presentations given during this meeting and have been selected in order to cover three main thematic areas of research at the intersection of Egyptology and Information Technology: (1) the construction, management and use of Ancient Egyptian annotated corpora; (2) the problems linked to hieroglyphic encoding; (3) the development of databases in the fields of art history, philology and prosopography. The contributions offer an up-to-date state of the art, discuss the most promising avenues for future research, developments and implementation, and suggest solutions to longstanding issues in the field.
Two general trends characterize the projects laid out here: the desire for online accessibility made available to the widest possible audience; and the search for standardization and interoperability. The efforts in these directions are admittedly of paramount importance for the future of Egyptological research in general. Indeed, for the present and increasingly for the future, one cannot overemphasize the (empirical and methodological) impact of a generalized access to structured data of the highest possible quality that can be browsed and exchanged without loss of information.
Notice des auteurs
Stéphane POLIS is Research Associate at the National Fund for Scientific Research (Belgium). His fields of research are Ancient Egyptian linguistics and Late Egyptian philology and grammar. His work focuses on language variation and language change in Ancient Egyptian, with a special interest for the functional domain of modality. He supervises the development of the Ramses Project at the University of Liège with Jean Winand.
Jean WINAND is professor ordinarius at the University of Liège, and currently Dean of the Faculty of Philosophy and Letters. He specializes in texts and languages of ancient Egypt. His major publications include Études de néo-égyptien. La morphologie verbale (1992); Grammaire raisonnée de l’Égyptien classique (1999, with Michel Malaise); Temps et Aspect en égyptien. Une approche sémantique (2006). He launched the Ramses Project in 2006, which he supervises with Stéphane Polis.
-
Le Vieil-Évreux (Eure – France) dans leur contexte chronostratigraphique
par Dominique CLIQUET (dir.)
Table des matières
Avant-propos | P. Depaepe et M. Otte Préface | J. Jaubert Introduction : Les fouilles du Long Buisson : un chantier – The site of Le Long Buisson : the excavations | C. Marcigny avec la collaboration de B. Aubry, V. Carpentier, D. Giazzon, G. Guillier, S. Hinguant, C. Hugot, H. Lepaumier et C. Lourdeau Déroulement de l’opération Les résultats Chapitre 1 : Le Paléolithique et l’épipaléolithique dans la région d’évreux : bilan des connaissances et apports de la fouille du site du Long-Buisson – The Palaeolithic and Epipalaeolithic of the region of Évreux: a review of the earlier evidence and the results of excavations on the site of Le Long-Buisson | D. Cliquet, B. Aubry, B. Huet, S. Bourdin-Launay & N. Roudié • Le Paléolithique et l’Épipaléolithique de la région d’Évreux : révision des collections du Musée d’Évreux, des séries Bordes et travaux récents • L’apport des travaux récents à la connaissance des occupations paléolithiques de la région d’Évreux • Un diagnostic conduit sur Le Long-Buisson I, tranchées 201 et 202 : artefacts et phénomènes périglaciaires • Le site du Long-Buisson à Guichainville / Le Vieil-Évreux (Eure) : quand la fouille de vestiges protohistoriques et historiques révèlent des occupations paléolithiques Chapitre 2 : Étude des remplissages tertiaires et quaternaires des dolines du plateau crayeux karstifié du Long-Buisson à Guichainville / Le Vieil-Évreux (Eure) : chronostratigraphie des niveaux anthropiques – The study of tertiary and quaternary sediments in sinkholes on the karstified chalk plateau of Le Long-Buisson to Guichainville /Le Vieil-Évreux (Eure): chronostratigraphy in the levels with evidence of human activity | J.-P. Lautridou (†), D. Cliquet, J.-L. Schwenninger & S. Coutard • Le cadre géologique et géomorphologique • Le Long-Buisson I • Le Long-Buisson I : essai d’interprétation. • Les sites du Long-Buisson II et III • Synthèse chronostratigraphique Chapitre 3 : Des occupations du Pléistocène moyen au Long-Buisson – Middle Pleistocene occupation remains in Le Long-Buisson | D. Cliquet • Le Long-Buisson I, Zone 6 : des artefacts du Pléistocène moyen, associés au palésol Iville V (coupe 1, couches 4-5) • Au Long-Buisson I, Zone 5 : une occupation de la fin du Pléistocène moyen, associée aux « limons jaunes » saaliens (deuxième doline, coupes 3, 3bis, 6, 7 & 7 bis) Chapitre 4 : Les assemblages lithiques associés au cailloutis du début du Dernier Glaciaire du site du Long-Buisson – The lithic assemblages associated with gravels of the Early Weichselian on site of Le Long-Buisson | B. Huet, D. Cliquet et S. Bourdin-Launay • Le Long-Buisson I, Zone 6 : la « série blanche”, un assemblage lithique associé au cailloutis de base weichselien, vraisemblablement rapportable au Pléistocène moyen • Long-Buisson I, Zones 5 et 6 : la « série maron », des artefacts collectés dans le cailloutis du début du Dernier Glaciaire • Le Long-Buisson II, Zone Heb. et villa gallo-romaine : les vestiges collectés dans le cailloutis du début du Dernier Glaciaire et dans les structures en creux des périodes historiques • Contexte des découvertes • Les vestiges paléolithiques • Résultats synthétiques de l’étude Chapitre 5 : L’assemblage lithique associé aux » sols noirs » du Début du Dernier Glaciaire : le Long-Buisson I, Zone 5 – Deuxième doline, coupes 9 & 9 bis, horizon 4 – The lithic assemblage associated with the black soils of the Early Weichselian: Le Long-Buisson I, Zone 5 – second sinkhole, sections 9 and 0bis, horizon 4 | D. Cliquet Chapitre 6 : Valeur et signification techno-typologique des assemblages lithiques du Long-Buisson et répartition spatiale des vestiges – Representativeness and significance of techno – typological lithic assemblages of Le Long-Buisson and the spatial distribution of remains on the site | D. Cliquet et B. Huet • Influence de la matière première sur les processus de mise en œuvre • Approche comparative des » séries blanches » des zones 5 et 6 • Approche comparative des » séries blanches » et de la « série marron » • La série associée aux » limons noirs » du début Weichselien • Quelles affinités pour la série associée aux » limons noirs » ? • Conclusion partielle • Analyse spatiale des artefacts des zones 5 & 6 Conclusion : En guise de bilan … – Discussion of the results…. | D. Cliquet, J.-P. Lautridou (†), B. Huet, S. Bourdin-Launay et B. Aubry • Les occupations du Pléistocène • Nature et fonction des sites • Processus techniques et traditions culturelles • La fin du Pléistocène supérieur (Paléolithique supérieur final) • Pour conclure … • Annexe : Guichainville / Le vieil-Évreux – Long-Buisson: Luminescence dating report – Guichainville / Le vieil-Évreux – Long-Buisson : rapport des datations par luminescence • J.-L. Schwenninger • Comments on the interpretation of the results • The physical basis of luminescence dating • Sample preparation • Measurement procedures Appendix 1 : Details of radioactivity data and age calculations Appendix 2 : Dose rate determination Appendix 3 : Statistics and error calculation Bibliographie Résumés – Abstract Index des noms de lieux Liste des contributeurs
-
par Marie VOURC’H Table des matières
Introduction Présentation générale : Art rupestre, environnement et archéologie La recherche en art rupestre scandinave Contexte environnemental : géographie, géologie et conditions climatiques Contextes archéologiques Synthèse Description des sites et inventaire général Finnmark Troms et Nordland Trøndelag Norrland Étude des gravures et peintures : iconographie et diffusions Caractères généraux Les figures anthropomorphes Les figures de bateaux Les figures animales Éléments de la culture matérielle représentés dans les gravures Empreintes (gravées) de pas et de mains Les motifs non figuratifs : géométriques et non identifiables Les cupules Organisation spatiale et intégration du support Interprétations : iconographie, symboles, mythes et réalité Contribution de l’analyse technologique à l’étude des gravures rupestres du site de Hjemmeluft/Jiebmaluokta, Alta (Finnmark) Moyens d’analyse Paramètres connus ou supposés Expérimentation et résultats Comparaison des piquetages expérimentaux avec les piquetages de Hjemmeluft, Alta Conclusions Conclusion Lexique thématique trilingue Bibliographie
-
Le Paléolithique supérieur européen. Bilan quinquennal 2006 – 2011 par Pierre NOIRET (ed.) Auteurs Russia – Anatoly | P. DEREVIANKO, Khizri A. AMIRKHANOV & Sergey A. VASIL’EV Roumanie et République Moldave | Vasile CHIRICA & Valentin-Codrin CHIRICA Greece | Dr. Eugenia ADAM Serbia | Dušan MIHAILOVIĆ & Bojana MIHAILOVIĆ Croatia | Ivor KARAVANIĆ, Darko KOMŠO & Nikola VUKOSAVLJEVIĆ Hungary | Viola T. DOBOSI Slovakia | Ľubomíra KAMINSKÁ Les pays tchèques | Martin OLIVA Allemagne du Sud : L’Aurignacien du Jura souabe | Harald FLOSS Belgique | Marcel OTTE & Pierre NOIRET Région Aquitaine : Dordogne, Gironde, Landes, Pyrénées Atlantiques | Michel LENOIR Des Pyrénées Atlantiques au Languedoc méditerranéen | François BON Italie centrale : Ligurie, Toscane, Latium, Abruzzes | Carlo TOZZI Italie du Sud | Paolo GAMBASSINI, Paolo BOSCATO, Adriana MORONI & Annamaria RONCHITELLI Cantabrian Spain | Lawence Guy STRAUS Catalogne | Josep Mª FULLOLA i PERICOT Nord du Portugal | Thierry AUBRY Southern Portugal | Nuno BICHO, João CASCALHEIRA, João MARREIROS & Telmo PEREIRA
-
Les ambivalences du réel
par Anthony GLINOER & Michel LACROIX
Présentation du volume
Volontiers snobé par les écrivains, qui pourtant l’ont souvent pratiqué, le roman à clés est suspect. Il ne l’est pas moins aux yeux des universitaires adeptes de l’herméneutique textuelle, qui le réduisent ordinairement à une opération de cryptage par l’écriture et de décryptage par la lecture. Trouver les bonnes clés (noms, lieux, événements) et les ajuster aux bonnes serrures seraient les seuls gestes appelés par ces romans lus en détournant la tête. À rebours de cette double doxa, qui simplifie les mécanismes du genre et l’identifie à un seul de ses nombreux avatars, les contributeurs au présent volume ont relevé le défi d’examiner vraiment, en les prenant au sérieux, un corpus diversifié de romans à clés — de Balzac à Jean-Benoît Puech et Olivier Rolin en passant par Rachilde, Proust et Simone de Beauvoir —, à côté d’autres formes de travail sur la référentialité telles que l’autofiction, les notices biographiques des dictionnaires parodiques, les biographies imaginaires ou encore la métafiction dans le cinéma de Woody Allen. L’attention se trouve ici portée non seulement sur le fonctionnement des œuvres retenues, mais aussi sur les dérèglements, les pratiques ludiques et les enjeux de pouvoir qui s’y cachent. Loin d’être une simple transposition de potins littéraires, le roman à clés ouvre ainsi sur une réflexion touchant aux frontières entre fiction et référence au réel.
Notice des éditeurs
Anthony GLINOER est professeur agrégé à l’Université de Sherbrooke et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’histoire de l’édition et la sociologie du littéraire.
Michel LACROIX est professeur à l’Université du Québec à Montréal.
Ils sont tous deux membres du Groupe de recherche sur les médiations littéraires et les institutions (legremlin.org), à l’origine de travaux sur les sociabilités imaginées (Tangence, 80, 2006), la bohème (Bohème sans frontière, 2010) et les Imaginaires de la vie littéraire (avec B.-O. Dozo, 2012).
-
Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau, Pierre Drieu la Rochelle, Paul Éluard par Olivier PARENTEAU Présentation du volume
Quand elle n’est pas pacifique, ce qui lui arrive rarement, la poésie française consacrée à la guerre entre 1914 et 1918 est patriotique, belliqueuse, germanophobe, mensongère, scolaire. C’est là tout ce qui a été retenu d’elle par l’histoire, cela peut se comprendre et, pour l’essentiel, cela n’est pas faux. Le présent essai revient sur ce corpus méconnu et désormais malaimé tant il est dévoré par la guerre. Il propose une vue synthétique des événements et une lecture serrée d’oeuvres poétiques qui, pour être mobilisées et par conséquent « en guerre », n’en sont pas moins absolument modernes. Leurs auteurs ? Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau, Pierre Drieu la Rochelle, Paul Éluard, mais aussi André Breton, Blaise Cendrars et Philippe Soupault. Chacun aura cherché une forme capable de dire cette guerre inouïe, jamais vue, qui défie au propre comme au figuré cette bien nommée folle du logis, l’imagination, pour tenter de dire ce que deviennent, au coeur de l’horrible, le temps, l’amour, la pensée, l’espérance. Toute la lyre va au front et fait en sorte que les outrances de la Grande Guerre passent à la littérature avec audace et inventivité, mais aussi avec sensibilité et humanité.
Notice de l'auteurOlivier PARENTEAU, docteur en Lettres françaises de l’université McGill, est professeur de littérature au Cégep de Saint-Laurent (Montréal, Québec). Il est membre du Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes (Crist).
-
par Pascal BRISSETTE & Marie-Pier LUNEAU (dirs)
Présentation du volume
Transvaluant les signes de l’échec et de la réussite, la malédiction de l’écrivain est l’un des grands mythes de la littérature moderne. « Il faut des malheurs, et des plus grands, pour faire ce qu’il y a de plus beau dans le plus beau des arts », écrivait un Louis de Bonald. « Le ressentiment est nécessaire à toute création artistique véritable », écrit plus près de nous un Michel Houellebecq. Ce mythe de la malédiction n’en est pas moins une croyance vécue, ayant orienté des vies entières d’artistes et d’écrivains. Un vaste continent de maudits se dessine ainsi, du XIXe au XXIe siècle, où le poète crotté voisine avec le styliste martyr de son art, où le nègre de génie le dispute au grand artiste sombrant dans la folie, où l’écrivain populaire ne se prive pas quelquefois de cette forme singulière de légitimité que procure le malheur. Le propos du présent volume n’est pas de dresser un nouveau palmarès des poètes maudits ou des acteurs obscurs de la scène littéraire, mais d’examiner les conditions de perpétuation d’une croyance — le malheur de l’auteur comme fondement de la valeur d’une oeuvre — à travers un ensemble de textes et d’images débordant les limites géographiques et culturelles de la France.
Notice des éditeurs
Pascal BRISSETTE est professeur à l’Université McGill. Il a publié des ouvrages sur les mythes littéraires en France (La malédiction littéraire, 2005; Bohème sans frontière, 2010, codir. A. Glinoer) et au Québec (Nelligan dans tous ses états, 1998).
Marie-Pier LUNEAU est professeure au Département des lettres et communications de l’Université de Sherbrooke et codirectrice du Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec (GRÉLQ). Elle s’intéresse à la figure de l’auteur et à l’édition populaire au Québec.
-
Approches sémiotiques et philosophiques des images par Anne BEYAERT-GESLIN & Maria Giulia DONDERO (éds)
Présentation du volume
Les images artistiques et scientifiques se ressemblent en de nombreux points parce qu’elles questionnent les formes et les instruments de la créativité, prennent position devant la tradition et visent la découverte. Cet ouvrage s’appuie sur la sémiotique et la philosophie pour dépasser les distinctions sommaires et affiner la comparaison. Il s’attache à quelques cas exemplaires d’images qui mettent en crise les distinctions commodes. Il leur offre un espace de transformation permettant de passer d’un monde à l’autre, ce qui permet d’apercevoir les modifications superficielles qu’implique le déplacement du sens mais aussi les obstacles qui les empêchent. Une première partie envisage l’importation des modèles et pratiques scientifiques par l’art. Déplaçant le point de vue, la seconde aborde l’esthétisation et le devenir artistique de l’image scientifique. L’observation de ces passages permet d’interroger les conditions de l’interprétation des images, c’est-à-dire les instruments théoriques et épistémologiques qui autorisent l’interrogation mutuelle. On découvre ainsi comment arts et sciences ne cessent de dialoguer au travers de leurs images, de s’interpeller mutuellement, d’interroger réciproquement leur rapport à la connaissance en réexaminant continument leurs différences. L’emprunt mutuel des modèles et procédures artistiques et scientifiques procède d’une démarche épistémique et introduit une possibilité de distanciation, une plasticité vis-à-vis du croire. Il permet d’interroger les paramètres d’évaluation de la découverte et de réexaminer le rapport à la connaissance de chacun des domaines.
Table des matières
Anne Beyaert-Geslin, L’art comme texte et comme pratique de laboratoire Odile Le Guern, La perspective, entre géométrie et esthétique Marion Colas-Blaise, L’art au risque de la science : les vitraux radiographiques de Wim Delvoye Bernard Darras, Étude sémiotique de la « vue d’artiste » dans l’illustration scientifique Jean-François Bordron, Image esthétique, image mathématique Catherine Allamel-Raffin, Un exemple d’étude comparée des procédures interprétatives à l’œuvre dans les sciences de la nature et dans l’analyse des œuvres d’art Maria Giulia Dondero, La totalité en science et en art François Wesemael (†) et Doris Daou, Entre art et science : objectifs, fonctions et nature de quelques images de la Lune depuis Galilée
Notice des éditeurs
Anne Beyaert-Geslin est professeure à Bordeaux Montaigne, directrice adjointe du laboratoire MICA et coordinatrice de l’ANR Images et dispositifs de visualisation scientifiques (2008-2010). Ses recherches se concentrent sur la sémiotique visuelle et la sémiotique du design et plus précisément sur les questions relatives au statut des images et à la créativité.
Maria Giulia Dondero est chercheure qualifiée du F.R.S.-FNRS et enseigne la sémiotique visuelle à l’Université de Liège. Elle a écrit sur l’intertextualité visuelle et les genres et publié trois ouvrages sur la sémiotique des images (artistique, scientifique, religieuse) dont le dernier en collaboration avec J. Fontanille, Des images à problèmes. Le sens du visuel à l’épreuve de l’image scientifique (Pulim, 2012).
-
(P.Monts. Roca inv. 158-161) Édition, traduction et analyse contextuelle d’un poème latin conservé sur papyrus
par Gabriel NOCCHI MACEDO
Présentation du volume
D’Euripide à T.S. Eliot, en passant par Gluck et Rilke, la figure d’Alceste, épouse aimante qui accepte de mourir à la place de son mari, a inspiré maint artiste. À la fin de l’Antiquité, un poète latin, dont l’identité nous est inconnue, composa des vers sur le mythe de la reine de Thessalie. Son poème aurait été à jamais perdu, si les sables d’Égypte ne nous en avaient pas livré une copie sur un papyrus du IVe siècle. Connu comme l’« Alceste de Barcelone », il représente un des apports majeurs de la papyrologie à notre connaissance de la littérature latine et, depuis sa première édition, en 1982, il n’a cessé d’attirer l’attention des spécialistes et des amateurs de culture classique. Le présent ouvrage propose une nouvelle édition du poème latin, accompagnée d’une traduction française, ainsi que d’un commentaire critique et linguistique. Exceptionnel à plusieurs égards, le manuscrit qui le contient fait l’objet d’une analyse codicologique et paléographique détaillée. On examine également son contexte de production et d’utilisation et, par extension, celui dans lequel l’« Alceste de Barcelone » a pu, de par sa langue, son style et son sujet, susciter l’intérêt dans l’Antiquité tardive. En filigrane aux discussions autour du texte et de son manuscrit, on aborde les questions de la transmission et la réception de la culture classique à la fin de l’Antiquité, notamment en Égypte, terre de riches entrecroisements culturels.
Notice de l'auteur
Gabriel Nocchi Macedo est titulaire d’une Maîtrise en Langues et Littératures Classiques de l’Université de Liège et aspirant du Fonds National de la Recherche Scientifique. Il prépare actuellement une thèse de doctorat sur les plus anciens livres latins de poésie. Poursuivant des recherches dans les domaines de la papyrologie, de la codicologie et de la paléographie, avec un intérêt particulier pour les papyrus et manuscrits latins, il est membre du Centre de Documentation de Papyrologie Littéraire (CEDOPAL) de l’Université de Liège, où il collabore à plusieurs projets.
-
Essais sur les dimensions iconiques de la connaissance par Jean-François BORDRON
Présentation de l'ouvrage
Ce livre propose un ensemble de réflexions sur le rôle de l’image dans le contexte de la connaissance scientifique. Il interroge pour ce faire des images d’astronomie, de mathématiques, de physique, de mycologie, de médecine, etc. L’image y est comprise comme étant simultanément un mode d’appréhension du monde, un lieu d’exercice de l’imagination mais également le lieu d’inscription et l’arrière-plan nécessaires à l’émergence des formes symboliques. Les images sont source d’extase mais elles sont aussi des lieux d’exercices rhétoriques, des actes dialectiques. Elles agissent et organisent le flux de notre expérience, en particulier lorsqu’il s’agit d’expérimentation scientifique. Si une image n’est pas nécessairement une preuve d’existence, elle a cependant de multiples rapports avec le fait d’être et donc avec la vérité. L’auteur cherche finalement à comprendre le lien essentiel de l’image à la vérité, question qui organise ce livre.
Notice de l’auteur
Jean-François BORDRON est professeur émérite de sémiotique à l’Université de Limoges. Il est philosophe de formation et a écrit un ouvrage intitulé Descartes. Recherches sur les contraintes sémiotiques de la pensée discursive (PUF, 1987) et qui s’interroge sur la méthode analytique du discours philosophique. Il a publié récemment L’iconicité et ses images. Études sémiotiques (PUF, 2011) ainsi que de nombreux articles sur le pragmatisme, la sémiotique de la perception et du goût, la méréologie des objets, la sémiotique visuelle, les machines, les objets sonores.
-
Problématiques, objets, concepts, méthodes, enjeux, débats par Marc ANGENOT Présentation du volume
L’histoire des idées bénéficie d’une pleine légitimité universitaire dans les mondes anglo-américain et germanique. Dans le monde de langue française au contraire, c’est une sorte de terrain vague où l’on aperçoit des passants, des squatters, des occupants sans titre. On n’y rencontre guère en tout cas de travaux de confrontation des méthodes et présupposés de cette discipline répudiée par la plupart des historiens « ordinaires ». Le présent ouvrage cherche à combler cette lacune. Ni traité, ni manuel, il aborde un vaste ensemble de questions, confronte les démarches des uns et des autres, expose les termes de controverses récurrentes. L’auteur y aborde la « vieille » question, déclinée de cent façons, du rôle des idées dans l’histoire. Genre hybride, l’histoire des idées combine historicisation et typologies, et opère sur le produit de vastes enquêtes d’archives. Mais elle comporte aussi, explicitement dans bien des cas, une intention polémique jointe à un engagement personnel, la présence d’un sujet qui interpelle ses contemporains par passé interposé.
Notice de l'auteurMarc ANGENOT est professeur émérite de l’Université McGill de Montréal, titulaire de la Chaire James-McGill d’étude du discours social et membre de la Société royale du Canada. Il est l’auteur de quelque trente ouvrages d’histoire des idées, d’analyse du discours et de rhétorique de l’argumentation dont, parmi les titres récents, Dialogues de sourds, traité de rhétorique antilogique (2008), En quoi sommes-nous encore pieux ? (2009), El discurso social (2010), Rhétorique de la confiance et de l’autorité (2013) et Les dehors de la littérature (2013).
-
Mythes et histoire à l’origine des interdits alimentaires par Youri VOLOKHINE Présentation du volume
Pourquoi certaines cultures rejettent-elles la chair du porc ? Les Grecs se posaient déjà la question, qui n’a cessé de revenir au devant de la scène. Étudier le porc en Égypte ancienne est une manière de mettre cette problématique à l’épreuve. En effet, depuis que les Grecs s’y sont intéressés, l’Égypte pharaonique se retrouve dans ce débat anthropologique puisque le porc, dit-on, n’y aurait pas été vraiment en odeur de sainteté. Viande malsaine ? Animal infâme ? Bête « taboue » ? L’objet de ce livre est de comprendre ce discours et de voir sur quoi il se fonde, en offrant une approche historique et anthropologique du cochon en Égypte ancienne. Le portrait de l’animal au sein de la culture pharaonique émerge très contrasté d’une analyse qui permet de réfléchir à la genèse des interdits religieux, aux discours qui s’y rapportent et aux choix culturels et identitaires qu’ils véhiculent. Ce véritable « roman du cochon » entend ainsi contribuer à une anthropologie de l’alimentation, tout comme à une histoire des relations entre les hommes et les animaux.
Notice de l’auteur
Youri VOLOKHINE, historien des religions et égyptologue, est Maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Genève (Sciences de l’Antiquité). Docteur ès Lettres (1998), il a été membre scientifique de l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO) au Caire. Il est l’auteur, notamment, de La frontalité dans l’iconographie de l’Égypte ancienne (2000). Ses recherches portent à la fois sur la religion de l’Égypte pharaonique et sur l’approche anthropologique des faits religieux.
-
Approches pluridisciplinaires des discours sur les perceptions autres que la vue par Bertrand VERINE (éd.)
Présentation du volume
Les recherches actuelles en sciences cognitives attestent que les perceptions de l’être humain font presque toujours coopérer deux ou plusieurs systèmes sensoriels, tandis que les recueils récents consacrés à l’expression des sensations constatent la rareté des travaux existants en dehors du champ visuel. C’est cette face ignorée de la perception et de sa mise en discours que scrutent ici une psychologue, deux historiens de la culture et six linguistes, qui croisent leurs approches sur les textes adressés par des personnes voyantes, malvoyantes et aveugles au concours d’écriture Dire le non-visuel pour le bicentenaire de Louis Braille. La mise en perspective historique de ces textes révèle la persistance globale en Occident, depuis l’Antiquité, d’une série de lieux communs que leurs auteurs s’emploient (souvent inconsciemment) à réécrire, tels que le caractère à la fois hégémonique et illusoire de la vue, la cécité comme malédiction ou comme voyance, l’indicibilité des sensations tenues pour inférieures...L’étude de ces réécritures cherche à identifier les ressources accessibles aux locuteurs non experts pour désigner les propriétés auditives, olfactives, tactiles et gustatives. Par-delà, l’observation des discours de personnes aveugles précoces permet de s’interroger sur la catégorie, apparemment paradoxale, des images tactiles à distance. Les neuf chapitres de l’ouvrage apportent ainsi de nouvelles réponses aux questions, classiques en philosophie et en psychologie, de la hiérarchie des sens, de l’existence, ou non, et de la spécificité éventuelle d’un « monde des aveugles » ou d’un « discours d’aveugle ». En citant des exemples nombreux et substantiels, tous s’attachent à la représentation langagière des sensations, non seulement en termes d’adéquation des mots aux choses, mais de fonctionnement cognitif et d’interaction des sujets avec leur environnement.
Table des matières
Bertrand Verine Mettre en discours les perceptions auditives, olfactives, gustatives et tactiles : le corpus du concours du bicentenaire de Louis Braille
Carl Havelange D'une rive à l'autre : la mise en récit des stéréotypes de la cécité
Alain Rabatel Du rôle du perceptuel en image dans la référenciation des perceptions autres que visuelles
Michèle Monte Des bruits et des odeurs. Étude lexicométrique et contextuelle de l’expression des perceptions dans le corpus FAF Dire le non-visuel
Catherine Détrie Les mots sont faits pour être vécus et non pas regardés : rôle esthétique ou nécessité esthésique de la métaphore dans la représentation des sensations?
Lucile Gaudin-Bordes & Geneviève Salvan L’hypallage : un opérateur synesthésique ?
Bertrand Verine Représentations perceptives et modalisation : l’insécurité discursive des perceptions autres que la vue
Viktoria von Hoffmann Les mots du goût : lieux communs et réécritures
Bertrand Verine Pour une approche des perceptions tactiles en discours
Virgínia Kastrup Images mentales de personnes aveugles congénitales et précoces : le cas des images tactiles distales
Notice de l'éditeur
Bertrand Verine enseigne la linguistique textuelle à l’université Montpellier 3. Ses recherches au laboratoire Praxiling portent sur l’organisation du discours et le marquage de la subjectivité dans l’oral spontané ou médiatique, et l’écrit – des SMS à la littérature.
-
(P.Lit.Lond. 165, Brit.Libr. inv. 137) Édition et traduction d’un papyrus médical grec du Ier siècle
par Antonio RICCIARDETTO
Acquis en 1889 par le British Museum, l’Anonyme de Londres est, à ce jour, le plus long papyrus médical grec conservé. Daté du Ier siècle de notre ère et provenant peut-être d’Hermopolis, en MoyenneÉgypte, il contient un texte autographe où sont exposées et discutées de nombreuses théories nosologiques, étiologiques et physiologiques, qui ont pour auteurs au moins vingt-cinq médecins et philosophes, dont peu sont postérieurs au IVe siècle avant notre ère et dont plusieurs sont inconnus par ailleurs. Après une introduction générale sur l’Anonyme de Londres, où sont notamment étudiés les circonstances relatives à la découverte et à l’étude du papyrus, ainsi que ses caractéristiques matérielles et son contenu, le livre présente l’édition critique, accompagnée de la première traduction française, des textes grecs du recto et du verso de ce témoin exceptionnel pour notre connaissance de la médecine et de la librairie antiques. Il est complété par deux bibliographies, l’une, relative aux textes du papyrus, l’autre, générale, par des index, en français et en grec, et par un fascicule de planches.
Antonio RICCIARDETTO est titulaire d’une Maîtrise en Langues et Littératures Classiques de l’Université de Liège et Aspirant du Fonds National de la Recherche Scientifique. Il prépare actuellement une thèse de doctorat sur les papyrus documentaires grecs de médecine. Poursuivant des recherches dans les domaines de la papyrologie et de l’histoire de la médecine, il est membre du Centre de Documentation de Papyrologie Littéraire (CEDOPAL) de l’Université de Liège, où il collabore à plusieurs projets.
-
Alternative, indépendance, auto-édition
par Christophe DONY, Tanguy HABRAND et Gert MEESTERS (éds)
En confrontant logiques de champs et de marchés, stratégies de légitimation et discours sociaux, culturels, politiques ou encore esthétiques, ce volume interroge l’apparition et les usages complexes de la notion de dissidence dans la bande dessinée contemporaine. Quelles formes prennent des pratiques éditoriales ou artistiques en rupture avec une certaine idée de l’ordre établi ? Comment déterminer les lignes de force et contradictions d’une (contre-)culture le plus souvent consciente d’elle-même ? À quels niveaux s’opèrent les échanges symboliques entre discours artistiques et discours critiques ? Prenant appui sur les démarches d’artistes et de structures éditoriales qui se réclament le plus souvent de l’alternatif ou de l’indépendance, cet ensemble de réflexions critiques explore des phénomènes du monde – dans son acception la plus large – de la bande dessinée.
Erwin Dejasse, Le regard cosmopolite et rétrospectif de la bande dessinée alternative Tanguy Habrand, Les Indépendants de la bande dessinée : Entre édition établie et édition sauvage Charles Hatfield, Do Independent Comics Still Exist in the US and Canada? Jean-Matthieu Méon, Tisser d’autres liens ? Pratiques éditoriales et discours critique de l’éditeur PictureBox : Indépendance et champ de la bande dessinée Christophe Dony, Reassessing the Mainstream vs. Alternative/Independent Dichotomy, or, the Double Awareness of the Vertigo Imprint Rudi de Vries, Balancing on the “Clear Line:” Between Selecting and Being Selected Independent Comics Publishing in the Netherlands: The Case of Joost Swarte and Oog & Blik Gert Meesters, The Reincarnation of Independent Comics Publishing in Flanders in the 21st Century: Bries and Oogachtend as Deceivingly Similar Cases Sylvain Lesage, L’édition sans éditeurs ? La bande dessinée franco-belge au prisme de l’auto-édition, années 1970–1980 Benoît Berthou, Pour une autre commercialisation de la bande dessinée : Étude sur La Gazette du Comptoir des Indépendants Thierry Groensteen, De l’An 2 à Actes Sud, une alternative à l’alternative Témoignage d’un éditeur Christophe Dony works as an assistant in the Department of Modern Languages and Literatures at the University of Liège, Belgium. His research focuses on the functions of inter- and hypertextuality in American comics. Tanguy Habrand est assistant à l’Université de Liège au sein du Département des Arts et Sciences de la Communication. Associé au CELIC (Centre d’Étude du Livre Contemporain), il mène une thèse consacrée à l’édition indépendante. Gert Meesters is assistant professor of Dutch at the University of Lille 3, Charles-de-Gaulle in France. He co-edited L’Association, une utopie éditoriale et esthétique (2011). His current research focuses on the stylistics of Belgian and French comics. -
Histoire, physiologie, géographie, intermédialités par François-Emmanuël BOUCHER, Sylvain DAVID et Maxime PRÉVOST (éds)
Les superhéros, demi-dieux d’un monde sans Dieu, constituent collectivement une mythologie laïque se diffractant en sous-ensembles de mythes modernes. Ceux-ci ont infiltré de manière durable l’imaginaire collectif. Dans une entrevue de 1985, Stan Lee, co-créateur de Spiderman, de Hulk, de Thor et des Quatre Fantastiques, entre autres superhéros, observait que quiconque s’intéresse au cinéma, à la littérature, à l’opéra, à la peinture ou à tout autre art de la représentation devrait aussi porter attention aux comic books, tout aussi déterminants que les autres arts populaires dans la constitution de l’imaginaire social. À l’heure où l’histoire culturelle n’a plus à prouver sa pertinence, un tel énoncé ne paraît plus paradoxal. Partant de l’affirmation d’Ernst Cassirer selon laquelle le mythe est « l’objectivation de l’expérience sociale de l’humanité », on pourra s’interroger sur la socialité de ces êtres d’irréalisme pur : comment, à quelles conditions et pourquoi est-il permis au lecteur ou au spectateur de s’identifier à un personnage dont les caractéristiques transcendent celles de l’humanité ordinaire ?
François-Emmanuël Boucher est professeur au Département d’études françaises du Collège militaire royal du Canada. Il a publié Les Révélations humaines. Mort sexualité et salut au tournant des Lumières (Peter Lang). Sylvain David est professeur au Département d’études françaises de l’Université Concordia. Il a notamment publié Cioran. Un héroïsme à rebours (Presses de l’Université de Montréal, « Espace littéraire »). Maxime Prévost est professeur au Département de français de l’Université d’Ottawa. Il est l’auteur de Rictus romantiques. Politiques du rire chez Victor Hugo (Presses de l’Université de Montréal, « Socius »). -
Le Paléolithique Supérieur d'Eurasie | Bilan 2014 par Pierre NOIRET & Denise LEESCH (éds) Table des matières
Ce bilan reprend des textes dont l’origine est variée. Trois contributions (V. Chirica, M. Anghelinu & C.-V. Chirica ; J.K. Kozlowski ; D. Leesch) font suite à la séance de la 8e Commission de l’UISPP qui s’est tenue à Neuchâtel (Suisse), les 11 et 12 février 2013, et lors de laquelle plusieurs collègues ont présenté un état de leurs recherches actuelles. Nous tenons à remercier très chaleureusement Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium et professeur associé à l’université de Neuchâtel, d’avoir bien voulu accueillir cette manifestation. Les autres textes sont, soit des rapports qui n’avaient pas été intégrés au précédent Bilan quinquennal 2006-2011, édité en 2013 (ERAUL 130), soit des mises à jour de contributions parues dans ce même bilan.
1. Les nouvelles découvertes archéologiques sur les sites du Paléolithique supérieur d’Ukraine |2007/2013 | Lioudmila Iakovleva 2. Roumanie |2011-2013 |Vasile Chirica, Mircea Anghelinu & Valentin-Codrin Chirica 3. Poland |Jarosław Wilczyński 4. Grèce : Nouvelles données et nouvelles controverses |Janusz K. Kozlowski 5. Greece |2011-2013 |Eugénia Adam 6. Hongrie |Tendances et problèmes |Zsolt Mester 7. Ligurie |Margherita Mussi 8. Italie nord orientale |2007/2012 |Marco Peresani 9. Suisse |1983/2013 |Chronologie, habitat et territoire |Denise Leesch 10. Luxembourg |2009/2013 |Foni Le Brun-Ricalens 11. France du Centre-Est |2011/2014 |(Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine & Rhône-Alpes) |Gérald Bereiziat 12. The Spanish Meseta |Carmen Cacho 13. Catalogne |2011/2013 |Josep Mª Fullola Pericot 14. Cantabrian Spain |2012/2014 |Lawrence Guy Straus 15. Vallée de l’Ebre |nouveautés et bilan |Pilar Utrilla et Rafael Domingo 16. Sud ibérique |2006/2013 |Miguel Cortés Sánchez
-
par Marcel OTTE & Foni LE BRUN-RICALENS (Coord.)
Table of content
Publication des actes du Colloque de la Commission 8 de l’UISPP, Liège, 29-31 mai 2012 Avec le Paléolithique supérieur d’Eurasie, les contacts territoriaux présentent une extrême extension, attestée par les matériaux et les entités culturelles. Quelles furent les traces de ces réseaux d’extension à longue distance et comment les interpréter ? Pourquoi furent-elles si abondantes et si nettes par rapport aux périodes précédentes et ultérieures ? Quels sont les modèles, actuels ou anciens, qui les justifieraient ? Quels furent les liens triangulaires qui expliquent l’extension de tels réseaux fondés sur un nouvel équilibre entre les paysages, les mythes et la démographie ?
With the Upper Palaeolithic of Eurasia, territorial contacts present an extreme expansion, attested by archaeological materials and cultural entities. What is the evidence for these long-distance expansion networks and how can it be interpreted? Why such evidence is so abundant and clear compared to preceding and subsequent periods? What are the current and former models that explain this expansion? What were the triangular links that explain the expansion of such networks based on a new equilibrium between landscapes, myths and demography?
Contributions réparties en six thèmes : Thème I : Asie Thème II : Europe orientale Thème III : Europe centrale Thème IV : Europe occidentale Thème V : Arts Thème VI : Débats généraux -
par Ariane WEINBERGER
Ariane Weinberger est ethnologue et anthropologue culturel. Elle offre ici un travail très novateur et pionnier quant à l’interprétation des oeuvres d’art paléolithiques. Son essai propose un nouveau regard sur la production artistique du Paléolithique supérieur européen, en particulier les Vénus en ronde-bosse et l’art pariétal des grottes profondes. Elle tente d’apporter de nouvelles réponses à d’anciennes questions :
Quelle est la plus ancienne manifestation du contact avec le «Dessein majeur» ? Comment et dans quel contexte s’est-il produit ? Quelles en furent les répercussions ? Existe-t-il un lien entre l’apparition de l’art novateur de Sapiens et la disparition de Neandertal ? Quelle est la plus ancienne trace d’expérience transcendantale au-delà des simples croyances post-mortem ? Quel niveau de profondeur fut atteint et par quels moyens ? Sous quelle forme cette expérience se matérialisa-t-elle dans le monde ? Quelles significations eurent le Féminin, le Bestiaire et la Grotte elle-même ? Que nous apprend ce type d’art sur la forme mentale, le niveau de conscience, le système de valeurs, la spiritualité et le style de vie de nos ancêtres ? Comment peut-on expliquer la simultanéité de l’apparition d’un art si homogène sur un continent si vaste ? In fine, quelles seraient les conditions requises pour un nouveau saut de conscience de notre espèce ?
Ariane Weinberger is an ethnologist and cultural anthropologist. She offers here highly innovative and pioneering research concerning the interpretation of Palaeolithic works of art. Her essay propose a new look at artistic production in the European Upper Palaeolithic, in particular the Venus figurines in the round and parietal art in deep caves. She attempts to contribute new responses to old questions:
What is the earliest manifestation of contact with the «Major Purpose»? How and in what context was it produced? What were the repercussions? Is there a link between the appearance of the groundbreaking art of modern humans and the disappearance of Neanderthals? What is the earliest evidence for transcendental experience beyond simple post-mortem beliefs? What level of depth was reached and by what means? Under what form was this experience materialized in the world? What meanings were given to the Feminine, the Bestiary and the Cave itself? What do we learn from this kind of art on mental form, the level of consciousness, the value system, spirituality and style in the lives of our distant ancestors? How can we explain the simultaneity of the appearance of an art so uniform across a continent so vast? Ultimately, what are the conditions required for a new leap in consciousness in our species?
-
A comparative perspective in diverse paleoenvironments par Masayoshi YAMADA & Akira ONO
Table of content
Preface, Marcel Otte Forward, Masayoshi Yamada Introduction, Akira Ono Part I – General perspectives 1.1 – Rivers as orientation axes for migrations, exchange networks and transmission of cultural traditions in the Upper Palaeolithic of Central Europe, Harald Floss 1.2 – The Contribution of obsidian characterization studies to early prehistoric archaeology, Tristan Carter 1.3 – The mesolithic project Ullafelsen in Tyrol (Austria), Dieter Schäfer 1.4 – Carpathian obsidians: state of art, Katalin T. Biró 1.5 – Paleolithic of Ukraine: The main diachronic and spatial trends of lithic raw materials exploitation, Vadim Stepanchuk Part II – Regional perspectives 2.1 – The raw material variability in the mesolithic site of Ullafelsen (Sellrain, Tyrol, Austria), Stefano Bertola 2.2 – Petroarchaeological research in the Carpathian Basin: methods, results, challenges, Katalin T. Biró 2.3 – Obsidian outcrops in Ukrainian transcarpathians and their use during the Paleolithic time, Sergey Ryzov 2.4 – Small opportunities and big needs: Mira Early Upper Paleolithic case of raw materials exploitation (Dnieper basin, Ukraine), Vadim Stepanchuk 2.5 – Obsidian exploitation and circulation in Late Pleistocene Hokkaido in the northern part of the Japanese Archipelago, Hiroyuki Sato & Miyuki Yakushige 2.6 – Upper Palaeolithic obsidian use in Central Japan: the origin of obsidian source exploitation, Kazutaka Shimada 2.7 – Acquisition and consumption of obsidian in the Upper Palaeolithic on Kyushu, Japan, Kojiro Shiba
-
par Jean-Pierre DUHARD & Brigitte et Gilles DELLUC Table des matières Préface, Yves Coppens Préambule Chapitre I – Description de la vulve A – Terminologie 1 – Terminologie des préhistoriens 2 – Terminologie des anatomistes B – La représentation paléolithique de la vulve 1 – Morphologie des vulves incorporées 2 – Influence de la culture et du support 3 – Le point de vue fessier de la vulve Chapitre II – Les représentations génitales féminines paléolithiques A – Le diagnostic de vulve féminine 1 – Reconnaître une vulve féminine dans la représentation 2 – Éliminer les représentations qui ne sont pas des vulves féminines B – Les représentations paléolithiques de la vulve Chapitre III – Corpus des représentations de vulves au Paléolithique Chapitre IV – Naturalisme des images génitales paléolithiques A – Les Paléolithiques et l’anatomie 1 – L’anatomie humaine externe 2 – L’anatomie humaine interne B – Le réalisme des vulves paléolithiques 1 – Réalisme et graphisme 2 – Le schématisme anatomique 3 – Le réalisme anatomique 4 – Raisons au défaut de réalisme « photographique » 5 – Le réalisme physiologique C – Réalisme et symbolisme 1 – L’évocation de la fécondité 2 – Sociologie de la sexualité 3 – L’évocation de la sexualité des Paléolithiques 4 – Les manifestations de la sexualité dans l’art des Paléolithiques 5 – La vulve et le sang Chapitre V – La vulve dans l’art paléolithique : comment, qui et pourquoi ? A – Une image vulvaire multiforme 1 – Montrée et cachée 2 – Miniature et démesurée 3 – Arrondie et angulaire 4 – Sur parois ou blocs et mobilière 5 – Associées entre elles 6 – Pariétale complétée par un corps humain 7 – Associée à un humain féminin 8 – Associée à un humain masculin 9 – Associée à un phallus 10 – Associée à un humain de sexe indéterminé 11 – Associée à un animal 12 – Uniques et isolées B – Qui sont les auteurs des œuvres ? 1 – L’âge des artistes 2 – Le sexe des artistes et la division sexuelle du travail 3 – Le révisionnisme féministe 4 – Des œuvres faites pour les hommes ? 5 – Que penser du rôle respectif de l’homme et de la femme dans les sociétés préhistoriques ? C – Pourquoi représenter des vulves ? 1 – La vulve, organe sexuel 2 – L’instinct de plaisir et l’hétérosexualité 3 – Une production artistique sexualisée dans les cavernes et abris 4 – Une production artistique sexualisée dans les gisements mobiliers 5 – Les « ex-votos » 6 – Les analogies entre pariétal et mobilier 7 – La vulve, première écriture 8 – La vulve, une des premières figurations des Paléolithiques 9 – La vulve, une forme d’écriture 10 – L’art et le langage 11 – L’orage hormonal de l’adolescence Conclusion Bibliographie
-
Palaeoanthropology and Context par TOUSSAINT Michel & BONJEAN Auteurs Michel Toussaint, Dominique Bonjean, Gregory Abrams, Sanda Balescu, Stefano Benazzi, Herve Bocherens, Mona Court-Picon, Freddy Damblon, Elise Delaunois, Dorien De Vries, Kevin Di Modica, Sireen El Zaatari, Christophe Falgueres, Paul Haesaerts, Catherine Hanni, Katerina Harvati, Jean-Jacques Hublin, Kristin L. Krueger, Kornelius Kupczik, Adeline Le Cabec, Rhylan McMillan, Anthony J. Olejniczak, Ludovic Orlando, Marcel Otte, Stephane Pirson, Donald J. Reid, Cheryl A. Roy, Matthew M. Skinner, Tanya M. Smith, Paul T. Tafforeau, Christine Verna, Yuji Yokoyama
-
par Jacques DUBOIS (éd.)
Présentation du volume
Amour et pouvoir. Sexe et révolte. Éros et Polis. Autant de duos thématiques qui passent pour difficiles à intégrer de façon couplée à une fiction romanesque. Stendhal en proscrivait l’alliance, tenant que les affaires publiques, toujours plus ou moins vulgaires, n’avaient pas à être mêlées aux affaires privées, plus raffinées. Et pourtant, tout au long du XXe siècle et selon des formules variables, le roman de langue française n’a guère cessé de mettre en scène ces deux registres éminents de l’activité humaine, tantôt pour les unir et tantôt pour les mettre en conflit. À chaque fois l’entreprise avait quelque chose de risqué : bien souvent on y touchait à des tabous et quelques-unes des oeuvres qui sont ici commentées ont choqué ou fait scandale. Le volume commence avec Proust, Desnos et Aragon, pour arriver à Ernaux, Houellebecq, Chessex et Carrère. Avec des textes de Danielle Bajomée, Jean-Pierre Bertrand, Benoît Denis, Laurent Demoulin, Laure Depretto, Paul Dirkx, Jacques Dubois, Pascal Durand, Karen Haddad, Maya Lavault, Jeannine Paque, Pierre Popovic, Dominique Rabaté, Matthieu Vernet.
Notice éditeur
Jacques DUBOIS est professeur émérite de l’Université de Liège. Spécialiste du roman français moderne et de la sociologie de la culture, il a donné dans l’esprit déjà du présent ouvrage Pour Albertine. Proust et le sens du social (Seuil, 1997) et Figures du désir. Pour une critique amoureuse (Les Impressions Nouvelles, 2011).
-
Musique, littérature, arts visuels par L. BELLOI, M. DELVILLE, Chr. LEVAUX, Chr. PIRENNE (éds)
Présentation du volume
Elles réunissent Joyce et Casares, Jonke et Emmanuel, réconcilient Schaefer et Ligeti, les Beatles et Eno, rapprochent Léger et Warhol, Atkins et Quino. Elles évoquent l’inertie et la mort chez les uns, la renaissance et la vie chez d’autres ; l’unique chez certains, le multiple chez beaucoup ; le même et le différent ou encore la perte et le repère. Elles se déploient dans les salles de concert, de cinéma ou de musée. Elles investissent les poèmes, les proses ou les cases de bande dessinée. Boucles et répétitions semblent bel et bien dominer la sphère artistique à l’aube du 21e siècle.
Le présent ouvrage se propose d’interroger les multiples usages et sens de la boucle et de distinguer cette structure des autres formes de répétition dans leur rapport au temps et à l’espace. Né sous les auspices du CIPA (Centre interdisciplinaire de Poétique Appliquée), ce volume prend également en considération, dans une perspective historique, les techniques propres aux différentes formes d’art où boucles et répétitions jouent un rôle prépondérant.
L’ouvrage vise par ailleurs à rendre compte des manières distinctes dont boucles et répétitions se modulent, en ayant soin de dépasser l’argument, trop souvent avancé, de la logique « non linéaire » dont elles procéderaient les unes et les autres.
Notices des éditeurs
Livio BELLOI est chercheur qualifié du Fonds national de la recherche scientifique et maître de conférences à l’Université de Liège. Son dernier ouvrage en date est : Film ist. La pensée visuelle selon Gustav Deusch (Lausanne, L’Âge d’Homme, 2013).
Michel DELVILLE enseigne la littérature anglaise et la littérature comparée à l’Université de Liège, où il dirige le Centre Interdisciplinaire de Poétique Appliquée. Ses ouvrages les plus récents sont consacrés aux relations entre les arts à l'époque contemporaine.
Christophe LEVAUX est chercheur doctorant à l’Université de Liège. Il travaille sur la construction des genres et des esthétiques de l’époque postmoderne.
Christophe PIRENNE enseigne l’histoire de la musique et les politiques culturelles dans les universités de Liège et de Louvain-la-Neuve. Il a publié divers ouvrages consacrés à l’histoire du rock.
-
Histoire, langage, esthétique et politique d’une émotion plurielle
par Michel DELVILLE– Andrew NORRIS– Viktoria von HOFFMANN (dirs)
Pourritures, cadavres, corruptions, insectes et vermines, puanteurs, horreurs visuelles, matières et saveurs repoussantes, ordures, secrétions et déchets corporels… Nombreux sont les objets qui, du plus lointain de nos histoires et de nos cultures, suscitent le dégoût et agressent notre système perceptif ; les sens sont touchés avec une immédiateté qui les entraîne irrésistiblement à l’écart de cet objet qui nous fait détourner le regard, nous boucher les narines, nous éloigner physiquement afin d’éviter contact et proximité avec ce qui répugne. Pourtant, le dégoût fascine. Les artistes s’en emparent qui, dans la littérature, la peinture, l’art performatif ou le cinéma, prennent pied et appui sur le dégoût, exaltant les motifs et la monstration de ce qui au départ révulse.
Comment définir le dégoût, malgré la multiplicité de ses objets ? Qu’en est-il de son histoire, tant du mot « dégoût » que du sentiment lui-même ? Quelles sont les relations qui unissent goût et dégoût ? Qu’en est-il du dégoût de soi ? Que dire, enfin, de la dimension éthique, politique et sociale d’une émotion qui pèse inévitablement dans les interactions humaines ?
L’étude du dégoût est difficile. En effet, cette « émotion plurielle » est dotée d’une connotation très négative et a souvent été laissée aux marges du savoir. Depuis quelques décennies, cependant, les disgust studies se multiplient. Douze chercheurs en sciences humaines, provenant des disciplines les plus variées, proposent ici une réflexion théorique commune, explorant l’histoire, le langage, la philosophie, la psychologie, l’éthique et l’esthétique du dégoût, convaincus que les réflexions les plus riches sur le sensible, les émotions, les affects ou les sentiments se fondent sur le dialogue entre disciplines, en confrontant les méthodes, les approches et les objets. Les figures multiples du dégoût explorées dans cet ouvrage révèlent une émotion-limite, qui échappe aux partages clairement institués, tant elle se caractérise par la profusion et l’indétermination, expliquant le trouble, l’ambivalence, et la fascination du dégoûtant.
Michel DELVILLE est l’auteur de Eating the Avant-Garde (2008), Crossroads Poetics (2013), Undoing Art (avec Mary Ann Caws, 2016) et de nombreux autres ouvrages consacrés aux études interdisciplinaires dans le domaine des sciences humaines.
Andrew NORRIS est l’auteur de Frank Zappa, Captain Beefheart and the Secret History of Maximalism (avec Michel Delville, 2005). Ses recherches actuelles portent sur les représentations culturelles de la faim.
Viktoria VON HOFFMANN a publié un ouvrage portant sur l’étude du goût intitulé Goûter le monde. Une histoire culturelle du goût à l’époque moderne (2013). Ses recherches les plus récentes se déploient vers l’histoire du toucher et de l’esthésie.
-
par Olivia RIVERO
La fin des temps glaciaires est marquée en Europe occidentale par la culture magdalénienne qui nous a laissé d’exceptionnels chefs-d’œuvre artistiques sur les parois des grottes, mais aussi des milliers de gravures sur de petits objets gravés ou sculptés en os ou bois de cervidé. L’analyse technique de ces objets, à l’aide d’instruments d’observation rapprochée comme le microscope électronique ou la loupe binoculaire, permet de reconstituer le geste de l’artiste et d’identifier certains stigmates de la chaîne opératoire. Ces infimes détails, invisibles à l’œil nu, révèlent des expertises et des savoir-faire très différents. Certains auteurs possèdent une maîtrise parfaite du maniement de l’outil et sont capables de créer des œuvres innovantes, d’un art consommé, sans défaut apparent ; d’autres, au contraire, montrent des défaillances techniques que révèlent de nombreux accidents de parcours dans la réalisation de chaque trait.
L’absence d’homogénéité dans la production artistique est révélatrice d’une société complexe, ayant développé des mécanismes de transmission des connaissances techniques, et notamment un processus d’apprentissage de la pratique artistique. A travers l’observation microscopique de centaines d’œuvres d’art mobilier, nous suivons pas à pas les gestes des artistes, experts ou débutants, qui nous apparaissent ainsi plus humains et plus proches de nous.
On trouvera dans cet ouvrage d’authentiques chefs d’œuvre intemporels, d’une saisissante beauté plastique, vus pour la première fois à travers le fort grossissement de la loupe binoculaire. Ces photomontages permettent d’entrer véritablement dans l’intimité de l’artiste préhistorique. Certes, la culture magdalénienne nous demeure profondément inconnue, mais l’universalité de l’art nous en révèle certains aspects.
-
Actes du colloque international (Liège, 13-15 octobre 2011)
par Magali DE HARO SANCHEZ (éd.)
De nombreux types d’écrits antiques conservent la mention ou le détail de pratiques magiques. Qu’il s’agisse de charmes isolés, tels que les amulettes et les tablettes de défixion, de manuels de magie, de sympathie, de palmomancie, ou de compilations d’écrits oraculaires, la mise par écrit de ce type de textes a permis la conservation d’un savoir peu accessible au travers des sources littéraires. S’inscrivant dans une approche résolument interdisciplinaire, cet ouvrage collectif contenant les actes d’un colloque international organisé à Liège du 13 au 15 octobre 2011, s’efforce de mieux cerner les conditions de la mise par écrit, de l’utilisation et de la transmission des sources de la magie antique, et de les replacer dans le cadre plus général du monde méditerranéen. Il croise les résultats des dernières recherches en philologie, papyrologie, épigraphie, égyptologie, assyriologie, histoire de la médecine et histoire des religions. L’ensemble s’articule autour de trois thématiques : la mise par écrit des textes magiques, la transmission des savoirs et la mise en contexte des pratiques.
Magali DE HARO SANCHEZ est Docteur en Langues et lettres (Papyrologie) de l’Université de Liège et membre du Centre de Documentation de Papyrologie Littéraire (CEDOPAL). À la fois papyrologue et égyptologue, elle est spécialisée dans l’étude des papyrus magiques. Elle est notamment l’auteur de nombreux articles sur les pratiques iatromagiques attestées dans les papyrus grecs et dans la littérature médicale gréco-romaine.
-
La réception internationale de la pensée de Pierre Bourdieu par Jacques DUBOIS, Pascal DURAND, Yves WINKIN (dirs)
La catégorie du symbolique joue un rôle central dans la pensée de Pierre Bourdieu. Elle a pourtant a été assez peu théorisée en tant que telle, alors que d’autres notions clés, comme celles d’habitus ou de champ, ont fait l’objet de reprises méthodiques et de commentaires minutieux. C’est à combler cette lacune que l’on s’emploie dans le présent ouvrage, en faisant valoir que le symbolique concentre la démarche du sociologue dans ce qu’elle a de plus singulier. Sociologues, philosophes, théoriciens du langage, spécialistes de la littérature ou des médias, les auteurs réunis ici procèdent à cette réévaluation sous trois aspects, qui correspondent à autant de champs de réflexion : anthropologie, culture et politique. Au-delà, c’est du rayonnement international de l’œuvre de Pierre Bourdieu qu’il s’agit de témoigner, et aussi de la diversité des objets qu’une même discipline de pensée continue de prendre en compte : de la gastronomie à la photographie, des littératures périphériques à l’art d’avant-garde, des politiques de contrôle social aux pratiques journalistiques. Le présent volume constitue une nouvelle édition des Actes du colloque qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 12 au 19 juillet 2001 avec la participation du sociologue, dont l’intervention est recueillie au sommaire. L’introduction générale en a été mise à jour afin de faire place aux développements apportés par celui-ci au concept de symbolique dans ses cours au Collège de France sur la genèse de l’État, publiés entre-temps. L’épilogue de l’ouvrage est assuré par l’écrivain Annie Ernaux.