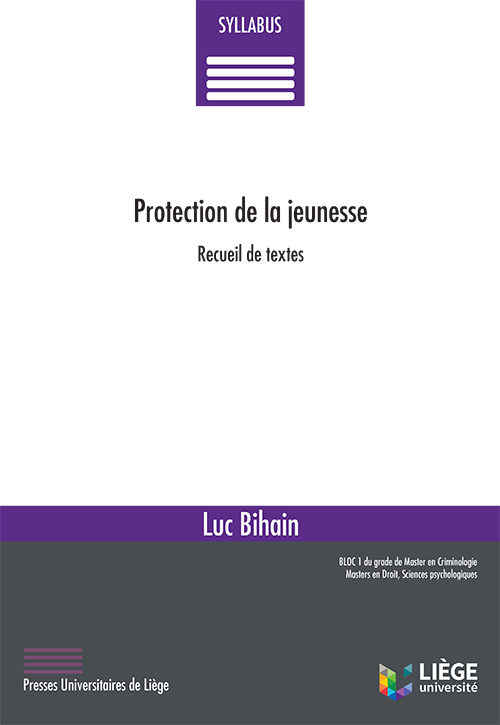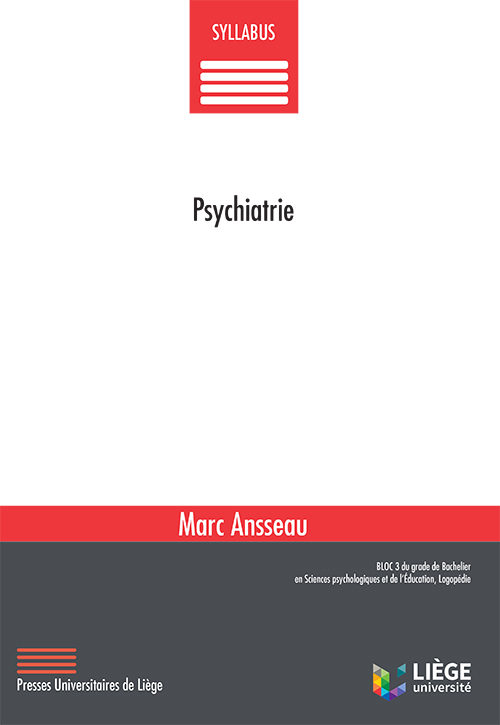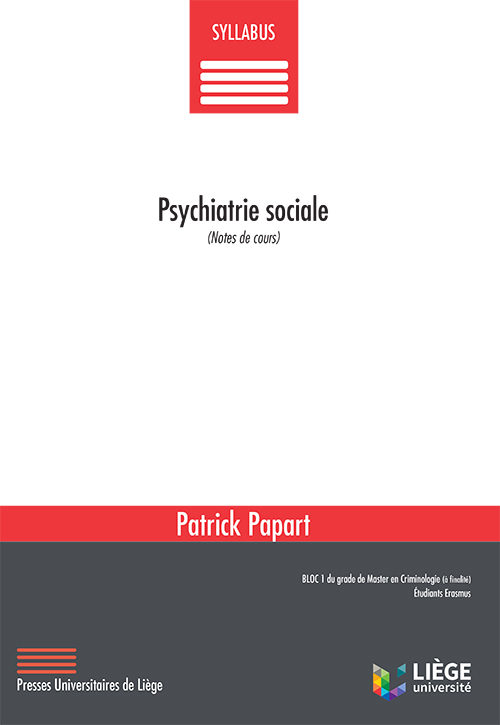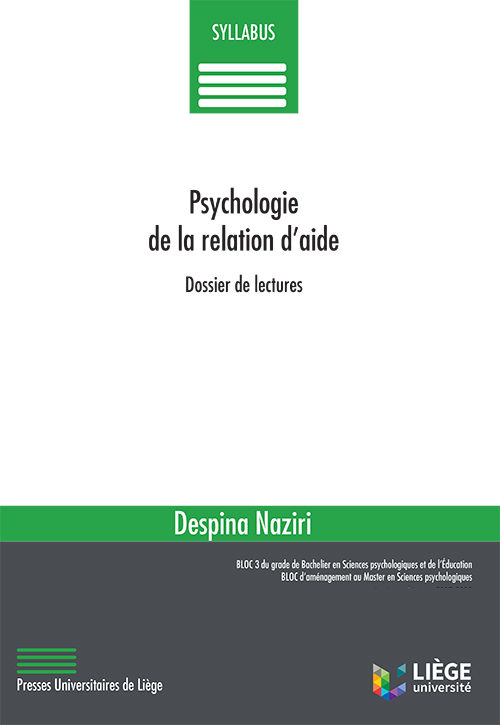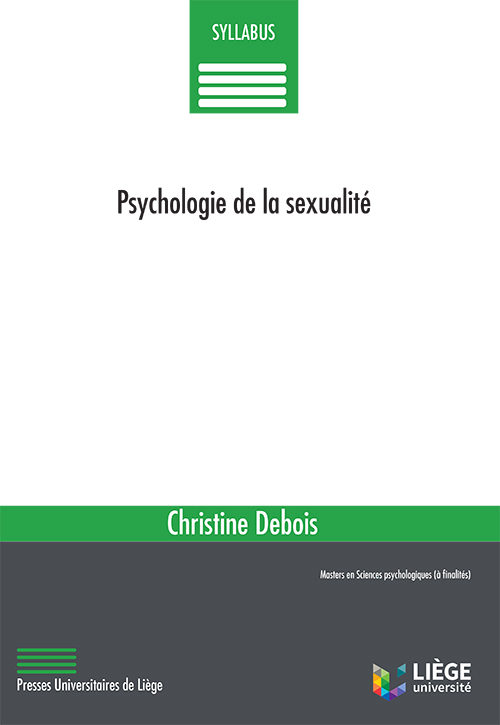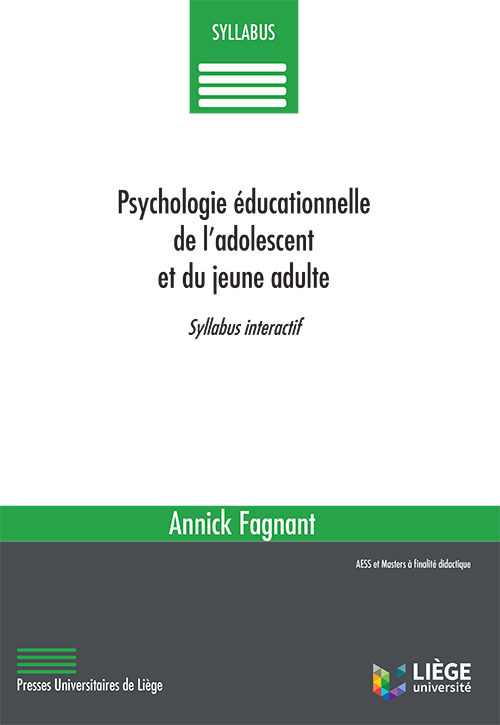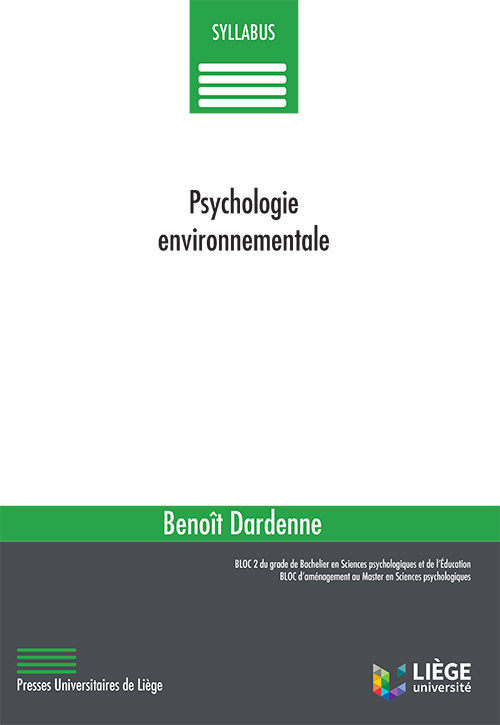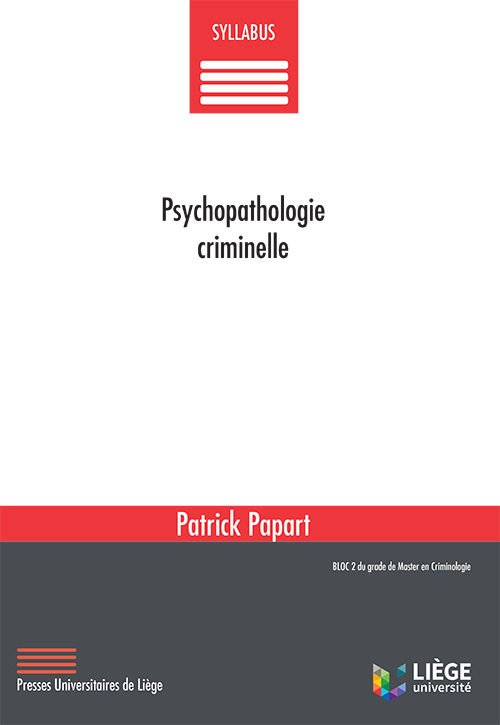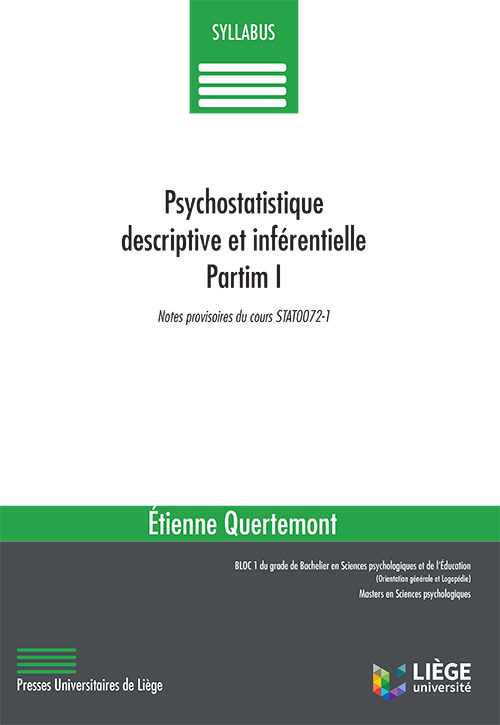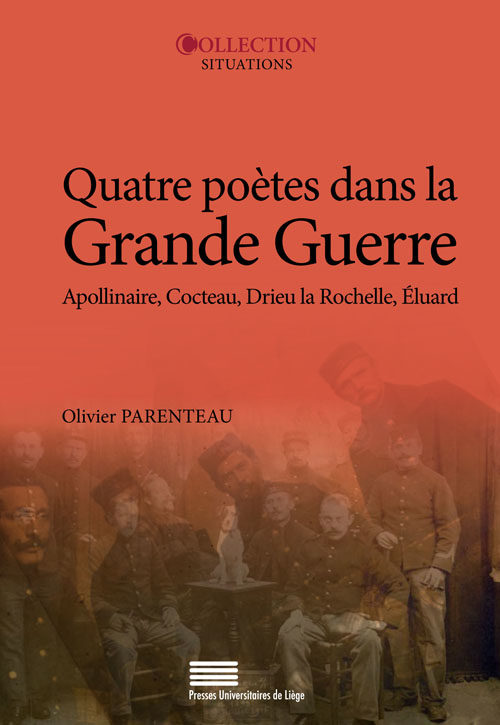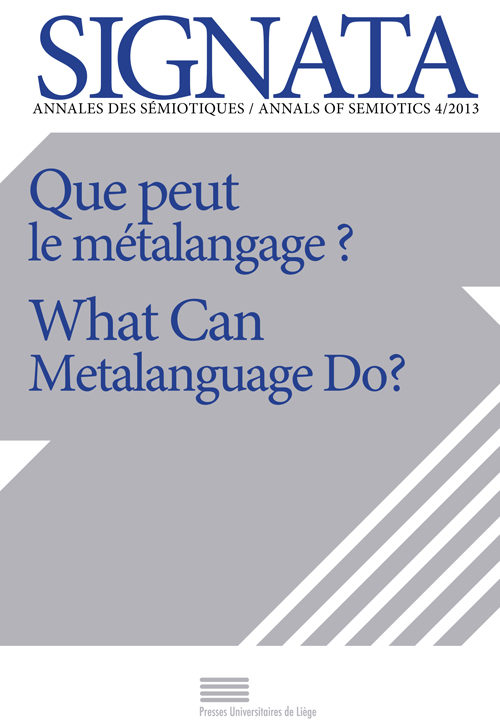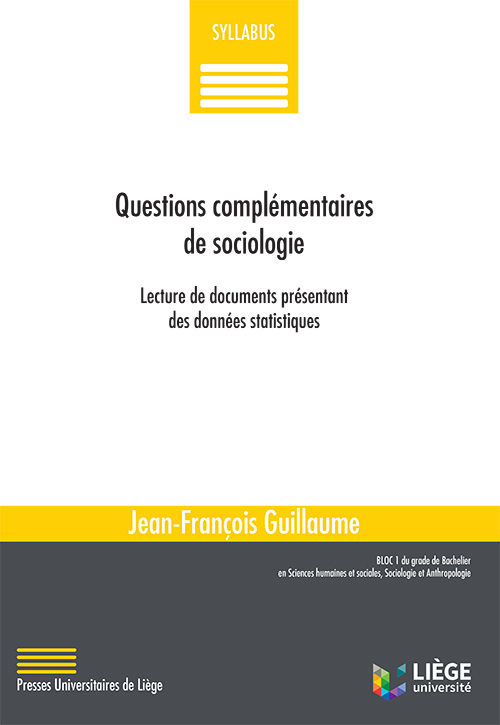-
Recueil de textes par BIHAIN, Luc BLOC 1 du grade de Master en Criminologie Masters en Droit, Sciences psychologiques
-
par ANSSEAU, Marc BLOC 3 du grade de Bachelier en Sciences psychologiques et de l’Éducation, Logopédie
-
Notes de cours par PAPART, Patrick BLOC 1 du grade de Master en Criminologie (à finalité) Étudiants Erasmus
-
Notes de cours par PAPART, Patrick BLOC 1 du grade de Master en Criminologie (à finalité) Étudiants Erasmus
-
Dossier de lecture par NAZIRI, Despina BLOC 3 du grade de Bachelier en Sciences psychologiques et de l’Éducation BLOC d’aménagement au Master en Sciences psychologiques
-
par DEBOIS, Christine Masters en Sciences psychologiques (à finalités)
-
Présensation PowerPoint par HANSENNE, Michel BLOC 2 du grade de Bachelier en Sciences psychologiques et de l’Éducation (Orientation : Générale et Logopédie) BLOC d’aménagement au Master en Sciences psychologiques (à finalité) BLOC 1 du grade de Master en Logopédie (à finalité)
-
Syllabus interactif par FAGNANT, Annick AESS et Masters à finalité didactique
-
par DARDENNE, Benoît BLOC 2 du grade de Bachelier en Sciences psychologiques et de l’Éducation
-
par PAPART, Patrick BLOC 2 du grade de Master en Criminologie
-
par PAPART, Patrick BLOC 2 du grade de Master en Criminologie
-
Dossier de lecture par NAZIRI, Despina BLOC 1 du grade de Master en Sciences psychologiques (à finalité spécialisée en Psychologie clinique)
-
Portefeuille de lectures par SCALI, Thérèse BLOC 1 du grade de Master en Sciences psychologiques (à finalité) BLOC 2 du grade de Master en Ingénierie de la prévention et de la gestion des conflits BLOC 1 du Certificat d’Université en Psychologie clinique à orientation psychopathologie
-
Partim I Notes provisoires du cours STAT0072-1 par QUERTEMONT, Étienne BLOC 1 du grade de Bachelier en Sciences psychologiques et de l’Éducation (Orientation générale et Logopédie) Masters en Sciences psychologiques
-
Partim II - Exercices Notes provisoires du cours STAT0073-3 par QUERTEMONT, Étienne BLOC 2 du grade de Bachelier en Sciences psychologiques et de l’Éducation, Logopédie
-
Partim II Notes provisoires du cours STAT0073-3 par QUERTEMONT, Étienne BLOC 2 du grade de Bachelier en Sciences psychologiques et de l’Éducation, Logopédie
-
Partim I - Exercices Notes provisoires du cours STAT0072-1 par QUERTEMONT, Étienne BLOC 1 du grade de Bachelier en Sciences psychologiques et de l’Éducation (Orientation générale et Logopédie) Masters en Sciences psychologiques
-
Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau, Pierre Drieu la Rochelle, Paul Éluard par Olivier PARENTEAU Présentation du volume
Quand elle n’est pas pacifique, ce qui lui arrive rarement, la poésie française consacrée à la guerre entre 1914 et 1918 est patriotique, belliqueuse, germanophobe, mensongère, scolaire. C’est là tout ce qui a été retenu d’elle par l’histoire, cela peut se comprendre et, pour l’essentiel, cela n’est pas faux. Le présent essai revient sur ce corpus méconnu et désormais malaimé tant il est dévoré par la guerre. Il propose une vue synthétique des événements et une lecture serrée d’oeuvres poétiques qui, pour être mobilisées et par conséquent « en guerre », n’en sont pas moins absolument modernes. Leurs auteurs ? Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau, Pierre Drieu la Rochelle, Paul Éluard, mais aussi André Breton, Blaise Cendrars et Philippe Soupault. Chacun aura cherché une forme capable de dire cette guerre inouïe, jamais vue, qui défie au propre comme au figuré cette bien nommée folle du logis, l’imagination, pour tenter de dire ce que deviennent, au coeur de l’horrible, le temps, l’amour, la pensée, l’espérance. Toute la lyre va au front et fait en sorte que les outrances de la Grande Guerre passent à la littérature avec audace et inventivité, mais aussi avec sensibilité et humanité.
Notice de l'auteurOlivier PARENTEAU, docteur en Lettres françaises de l’université McGill, est professeur de littérature au Cégep de Saint-Laurent (Montréal, Québec). Il est membre du Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes (Crist).
-
par COLLECTIF
Que peut le métalangage ?
Dans les sciences humaines, les recherches portées par un langage qui se donnât d’emblée comme technique ne sont pas toujours vues d’un bon œil. C’est notamment ce qui se passe pour la sémiotique. Cette discipline a, au pire, la réputation de volontiers jargonner, ou, au mieux, celle de se renfermer dans un métalangage autoréflexif. Et il est vrai que, d’une part, le traité de sémiotique structurale sans doute le plus connu et le plus souvent cité, dû à Greimas et Courtés, a pris la forme d’un Dictionnaire raisonné, et que d’autre part les écrits de Peirce fourmillent d’inventions et de spéculations terminologiques. Il semble que dans les deux cas, la quête de scientificité ait primé sur l’élégance de la langue et du discours dits naturels. Rien de nouveau sous le soleil ? On raconte que déjà un courtisan du Roi-Soleil avait scandalisé la Cour parce qu’il avait prononcé un terme technique dans la chambre du roi : c’est dire combien la question est ancienne et ne date pas du développement de la discipline des signes. Le numéro 4 de Signata voudrait questionner les différents aspects de la constitution du métalangage de la sémiotique. Et cela non pas dans une perspective philologique, mais pour poser la question des terminologies dans l’épistémologie scientifique actuelle. On interrogera ainsi la diversité des métalangages possibles (langue naturelle ou langage technique ?), l’impact des cousinages disciplinaires (quelle portée a pour la sémiotique ses emprunts divers aux langages de la grammaire, de la logique, de la mathématique…?), les raisons, explicites ou non, des choix opérés, ou encore les impacts stylistiques de ces derniers. Un tel questionnement pourrait prendre plusieurs orientations. En voici un inventaire, ouvert et non exclusif.
Table des matières
Dossier
1. Critique du métalangage Laurence Bouquiaux, François Dubuisson, Bruno Leclercq, Modèles épistémologiques pour le métalangage Gian Maria Tore, La réflexivité. Une question unique, des approches et des phénomènes différents Pierluigi Basso Fossali, Réflexivité critique et modélisation. Enquêtes sémiotiques sur les rôles du métalangage dans l’activité théorique en sciences humaines
2. Relectures de la tradition Alessandro Zinna, L’épistémologie de Hjelmslev. Entre métalangage et opérations Sémir Badir, Système à tous les étages 3. Propositions disciplinaires Jean-Pierre Desclés, Intersémiotique et langues naturelles Francesco Galofaro, Formalizing Narrative Structures. Glossematics, Generativity, and Transformational Rules Jean-Yves Trépos, Topologie des métalangages dans les textes de sociologie 4. Travaux en sémiotique perceptive Jean-François Bordron et Audrey Moutat, Métalangage et épi-sémiotique. L’exemple du lexique de la dégustation Anne Dymek, L’iconicité filmique. Un métalangage de la perception ? Stefania Caliandro, Métavisuel et perception. Une investigation sur la définition d’une fonction sémiotique en art Odile Le Guern, Métalangage iconique et attitude métadiscursive Overview Cosimo Caputo, Le paradoxe du métalangage Varia Martin Lefebvre, Image logique, ressemblance et langage. À propos de Peirce et Wittgenstein Marcel Danesi, Metaform Theory Groupe µ, Sémiotique de l’outil. Anasémiose et catasémiose instrumentées -
par GUILLAUME, Jean-François BLOC 1 du grade de Bachelier en Sciences humaines et sociales, Sociologie et Anthropologie